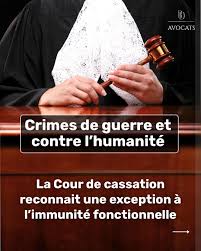Une décision de principe attendue : l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a tranché, lundi 28 juillet 2025, une question juridique majeure portant sur l’immunité des représentants d’État étrangers en matière de crimes internationaux.
Dans un arrêt solennel et inédit, la plus haute juridiction judiciaire française a accepté de reconnaître des exceptions à l’immunité fonctionnelle pour des faits constitutifs de crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide, tout en refusant de lever l’immunité personnelle des chefs d’État en exercice, même en cas de soupçons de crimes internationaux.
L’immunité fonctionnelle peut être écartée pour les crimes les plus graves
La Cour s’est prononcée sur deux pourvois liés à la Syrie. Le premier concernait Adib Mayaleh, ancien directeur de la Banque centrale syrienne, mis en examen pour complicité de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, pour avoir permis à la banque centrale de coopérer avec une entreprise impliquée dans la fabrication d’armes chimiques.
L’Assemblée plénière a jugé que la coutume internationale évolue, citant la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, de tribunaux suisses et allemands, et des législations étrangères comme celles de l’Espagne et de l’Autriche. Selon elle, un nombre significatif d’États accepte désormais que l’immunité fonctionnelle puisse être écartée en cas de crimes internationaux, une tendance appuyée par des organismes comme la Commission du droit international de l’ONU ou l’Institut de droit international.
« La Cour de cassation entend contribuer à cette évolution », a affirmé son premier président, Christophe Soulard, ajoutant que l’immunité fonctionnelle « ne peut pas être opposée en cas de poursuites pour génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre ». Elle a donc rejeté le pourvoi de l’ancien responsable syrien, confirmant ainsi sa mise en examen en France.
L’immunité personnelle des chefs d’État en exercice reste intacte
Le second pourvoi concernait le mandat d’arrêt international délivré en 2023 contre le président syrien Bachar al-Assad, pour son rôle présumé dans les attaques chimiques d’août 2013 dans la Ghouta orientale.
Malgré la non-reconnaissance par la France de son gouvernement à cette époque, la Cour a estimé que l’immunité personnelle des chefs d’État ne dépend pas de la reconnaissance politique de leur régime par un État tiers. Elle s’appuie notamment sur l’article 29 de la Convention de Vienne (1961) et sur la jurisprudence de la Cour internationale de justice, qui considèrent l’immunité personnelle comme nécessaire à l’exercice des fonctions régaliennes et à la préservation de la souveraineté des États.
Conditionner l’immunité à la reconnaissance serait ouvrir la voie à des poursuites arbitraires contre des chefs d’État en exercice, au gré des relations diplomatiques », a averti M. Soulard.
La Cour a donc cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction, annulé le mandat d’arrêt contre M. Assad, et réaffirmé que la coutume internationale ne reconnaît pas, à ce jour, d’exception à l’immunité personnelle en matière pénale pour les chefs d’État en exercice, même en cas de crimes internationaux.
Des poursuites possibles après la fin du mandat
La Cour a toutefois rappelé que l’immunité personnelle est temporaire. Une fois le chef d’État déchu, comme c’est le cas de Bachar al-Assad aujourd’hui, de nouveaux mandats d’arrêt peuvent être délivrés, notamment pour des faits qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité.
« L’application de l’immunité personnelle ne signifie pas impunité », a insisté le Premier président. Les crimes reprochés peuvent toujours être jugés dans le pays d’origine ou devant une juridiction pénale internationale.
Une décision à portée internationale
Cette double décision est un signal fort de la Cour de cassation française dans la lutte contre l’impunité pour les crimes les plus graves, tout en maintenant l’équilibre des relations internationales. En reconnaissant l’exception à l’immunité fonctionnelle dans le cadre des crimes internationaux, elle s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle internationale. En refusant de remettre en cause l’immunité personnelle, elle reste alignée sur le droit international actuel, tout en ouvrant la voie à des poursuites post-mandat.
Les deux procédures judiciaires, tant contre Adib Mayaleh que contre l’ancien président syrien, peuvent désormais se poursuivre en France.