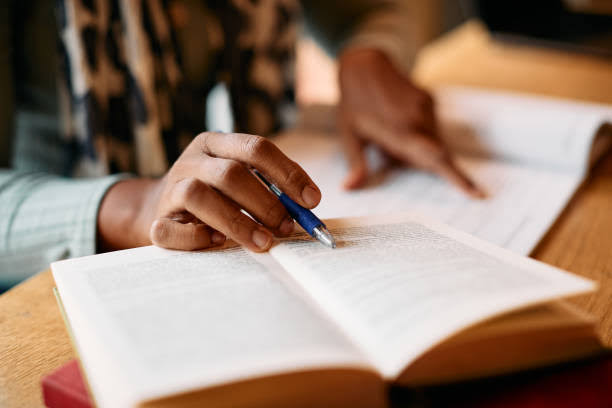Pendant trop longtemps, l’éducation a été considérée comme un miroir de notre identité. Cette approche est non seulement nostalgique, mais aussi prescriptive. Elle risque d’enfermer le programme dans des identités passées au lieu de préparer les citoyens aux réalités futures.
L’éducation doit plutôt être comprise comme une base d’orientation commune – un fondement qui permet aux individus d’interpréter, de choisir et d’agir face à la complexité mondiale.
La métaphore est simple. Imaginez que les auto-écoles enseignent des règles contradictoires : pour un élève, un feu rouge signifie « stop », tandis que pour un autre, c’est « passer ». Les routes seraient jonchées d’accidents et de confusion. Tel est le danger d’une éducation fragmentée. Dans un monde façonné par la mondialisation, les bouleversements technologiques et la pression climatique, les citoyens ont besoin de points de repère communs. Sans eux, la prise de décision collective est compromise.
Il ne s’agit pas d’un argument en faveur du contrôle, mais de l’autonomisation. Un programme scolaire ancré dans l’abondance et le potentiel créatif peut donner aux jeunes davantage d’outils pour faire les bons choix et agir avec plus de conscience au sein de leurs communautés, de leurs économies et de leurs démocraties. L’éducation informelle par la musique, la famille et la communauté a longtemps comblé les lacunes laissées par l’État. Mais aujourd’hui, ces lacunes sont trop importantes pour être négligées. Il est urgent de repenser l’éducation formelle.
La tâche est vaste. L’histoire doit dépasser les chronologies coloniales pour inclure le patrimoine autochtone, les récits de migration et les forces mondiales qui continuent de façonner la région. La géographie et la culture doivent être enseignées comme étant interconnectées, reliant les écosystèmes caribéens aux politiques climatiques mondiales, ou les traditions musicales locales aux industries culturelles mondiales. La langue est également importante, notamment dans la mesure où les mots choisis pour décrire les personnes et les lieux façonnent la façon dont les enfants se représentent le monde. Comme l’a souligné l’UNESCO : « Les programmes scolaires doivent être repensés pour valoriser la diversité des savoirs, y compris les systèmes de savoirs autochtones, et pour cultiver l’esprit critique, la créativité et la coopération. »
Il s’agit également d’une nécessité économique. Le Traité révisé de Chaguaramas engage les États de la CARICOM à assurer la libre circulation des professionnels qualifiés et des services dans le cadre du Marché et de l’Économie uniques. Cette vision ne peut aboutir si les citoyens ne disposent pas de qualifications, de compétences et d’une connaissance des normes régionales comparables. Sans fondements communs, des initiatives comme le CSME risquent de stagner, car les citoyens ne sont pas en mesure de gérer leurs droits, leurs responsabilités et leurs opportunités au-delà des frontières.
L’alternative est coûteuse. Les pressions migratoires s’accentueront si l’éducation ne prépare pas les jeunes aux opportunités locales. Les inégalités se creuseront si seule l’élite accède aux compétences pertinentes et porteuses d’avenir. Et la confiance démocratique s’érodera si les citoyens ne parviennent pas à replacer les débats contemporains – sur la souveraineté, le climat ou la technologie – dans un contexte commun.
La réforme ne sera pas simple. Elle exige du courage politique, une consultation publique et des investissements à long terme. Mais l’enjeu est considérable. Un système éducatif servant de référence plutôt que de miroir peut ancrer les Caraïbes dans les tempêtes du changement mondial. Il peut donner aux citoyens la capacité non seulement d’interpréter le monde, mais aussi de le façonner – ensemble.
La culture continuera d’inspirer, la musique d’enseigner et les familles de transmettre leur sagesse. Mais l’État ne doit plus s’appuyer sur ces canaux informels pour porter le poids de l’orientation nationale. Cette responsabilité relève du programme scolaire, et elle en fait partie dès maintenant.
Si la souveraineté doit avoir un sens aujourd’hui, elle doit inclure la souveraineté sur le savoir. L’éducation n’est pas une question de nostalgie. Il s’agit de donner aux citoyens la clarté et le contexte nécessaires pour faire des choix judicieux. Dans un monde fragmenté, ce socle commun pourrait bien être la plus grande force des Caraïbes.