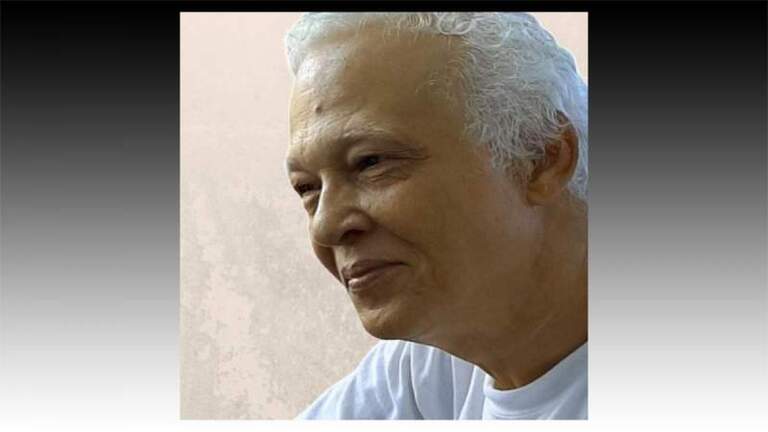Le spectre du retour de la diplomatie de la force
Le spectre du retour à une diplomatie de la force refait surface dans la région caraïbe, rappelant les heures sombres de la doctrine du Big Stick qui, au début du XXᵉ siècle, permettait aux États-Unis d’imposer leur loi sur leur « arrière-cour ». Aujourd’hui, face au Venezuela et à d’autres nations jugées rebelles à l’ordre économique occidental, Washington renoue avec cette logique interventionniste, sous couvert de défense des droits de l’homme ou de lutte contre les trafics.
Cette démonstration de puissance traduit en réalité la volonté américaine de reprendre le contrôle d’un espace stratégique convoité, riche en hydrocarbures, en ressources minières et en positions géopolitiques clés. Ce qui se joue dans la Caraïbe résonne étrangement avec les dynamiques observées sur le continent africain : dans les deux cas, la domination contemporaine s’exerce moins par la conquête militaire que par l’influence économique, technologique et idéologique.
Les nouveaux champs de bataille du monde multipolaire
La Caraïbe et l’Afrique sont aujourd’hui les champs de bataille géopolitiques où risquent fort de se réinstaller, très bientôt, le colonialisme économique et numérique. Elles deviennent les laboratoires d’une recomposition du monde, où les anciennes puissances, déclinantes, cherchent à préserver leur suprématie dans un contexte de rivalités globales exacerbées. La géopolitique contemporaine est dominée par les grandes puissances – la Chine, les États-Unis, l’Union européenne, la Russie et l’Inde – tandis que la Caraïbe et l’Afrique restent en marge. Cette exclusion accroît le risque géopolitique, marqué par les guerres, le terrorisme et les tensions économiques, et ramène la recolonisation de l’Afrique au cœur de l’actualité.
Sous le voile de la mondialisation : un néocolonialisme rampant
Derrière les discours sur la mondialisation, le développement durable et la coopération internationale, se cache une réalité brutale : celle d’un continent à nouveau soumis à des dynamiques de domination économique, politique et technologique. L’Afrique, riche de ses ressources naturelles et humaines, demeure paradoxalement l’un des espaces les plus vulnérables aux appétits des grandes puissances.
Crises internes et vulnérabilités structurelles
Malgré sa croissance démographique spectaculaire – 2,5 milliards d’habitants attendus d’ici 2050 –, la pauvreté reste endémique. L’Afrique dépend encore trop des exportations de matières premières, tandis que les inégalités et l’instabilité politique freinent toute émergence durable. À cela s’ajoute la pression climatique, amplifiant sécheresses, inondations et déforestation. Ces crises conjuguées alimentent un cercle vicieux de dépendance, où la souveraineté s’effrite face aux intérêts étrangers.
Une ruée contemporaine vers les ressources africaines
Les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Union européenne, la Turquie ou les monarchies du Golfe se disputent désormais le dernier grand réservoir de ressources du XXIᵉ siècle. Sous couvert de coopération, l’Afrique est redevenue un champ de bataille géopolitique. La Chine avance ses pions avec les Nouvelles Routes de la Soie, la Russie avec le groupe Wagner, les États-Unis par l’AFRICOM, et la France, malgré son recul, conserve une influence économique majeure.
Vers un néocolonialisme énergétique et numérique
Cette ruée illustre un néocolonialisme énergétique : au nom de la sécurité ou de la transition écologique, les puissances du Nord s’arrogent le contrôle des richesses africaines. Près de 93 millions d’hectares de terres africaines ont déjà été cédés à des puissances étrangères. Dans le même temps, un colonialisme technologique s’installe. La domination ne s’exprime plus seulement par la force, mais par la dépendance numérique et l’accès inégal aux données.
Le risque d’une recolonisation invisible
Les gouverneurs coloniaux ont été remplacés par des algorithmes et des serveurs. Sous couvert de progrès, un colonialisme numérique s’installe : captation de données, dépendance technologique, standardisation culturelle. Le développement de l’intelligence artificielle accentue les fractures entre Nord et Sud. Celui qui maîtrise la technologie maîtrise la conscience collective et la production de sens.
Pour une souveraineté technologique de la Caraïbe et de l’Afrique
Face à cette recomposition, l’Afrique et la Caraïbe sont à un tournant historique. Leur avenir dépendra de leur capacité à bâtir une souveraineté technologique et intellectuelle. Investir dans la formation, la recherche et la production numérique locale est la condition de leur émancipation. Le néocolonialisme du XXIᵉ siècle est fluide, silencieux et codé. Mais il n’est pas inéluctable : les peuples peuvent encore reconquérir leur souveraineté par la maîtrise du savoir et de la technologie.
Jean-Marie Nol
Économiste et juriste en droit public