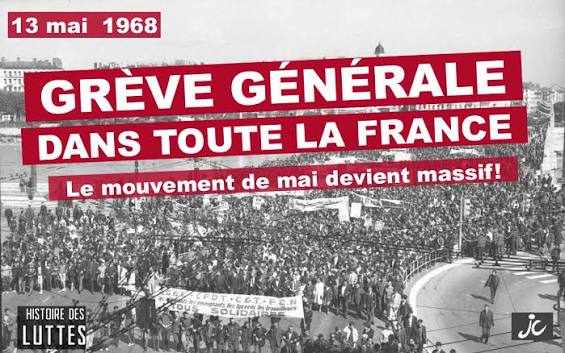Dans son article publié sur notre site, Maurice Laouchez propose une lecture sévère de Mai 68, qu’il considère comme le moment fondateur d’un basculement culturel ayant désorienté la société française. Il pointe la rupture avec l’autorité, l’essor de l’individualisme, la mise en cause des institutions, le triomphe d’un relativisme culturel et l’avènement d’une modernité jugée sans repères. Cette grille de lecture éclaire indéniablement certaines tensions contemporaines. Elle mérite toutefois d’être complétée par une autre perspective : celle des transformations positives que Mai 68 a rendues possibles.
La critique de l’autorité traditionnelle n’a pas seulement fragilisé les cadres anciens ; elle a ouvert la voie à leur modernisation. Dans les entreprises comme dans les écoles, elle a contribué à instaurer davantage de dialogue, à promouvoir des pratiques pédagogiques moins verticales et à encourager des formes de responsabilité partagée. L’autorité n’a pas disparu : elle s’est recomposée, parfois rendue plus légitime parce que plus explicite.
Ce que Laouchez interprète comme l’avènement d’un individualisme triomphant peut également se lire comme un puissant mouvement d’émancipation. Les droits des femmes ont progressé, la parole des jeunes a été reconnue, les minorités ont accédé à une visibilité nouvelle. La libération des corps et des mœurs a constitué l’un des grands acquis démocratiques de la période, donnant à l’autonomie personnelle une place centrale dans la citoyenneté moderne.
Les institutions, loin d’avoir été délégitimées, ont été poussées à se réformer. L’université s’est ouverte, les contre-pouvoirs se sont affirmés, la société civile a pris place dans le débat public. Le pluralisme médiatique, l’essor des radios libres et la diversification des voix publiques figurent parmi les héritages les plus tangibles de cette séquence historique.
Le relativisme culturel souvent associé à 1968 peut aussi être compris comme un élargissement du paysage intellectuel et culturel. La reconnaissance des cultures populaires, des langues régionales, des expressions ultramarines ou encore des savoirs issus des sciences sociales a enrichi la vie culturelle française. La culture classique n’a pas été effacée : elle s’est trouvée réinscrite dans un ensemble plus large et plus vivant.

Enfin, la modernité incertaine décrite par Laouchez a également porté un imaginaire démocratique nouveau. L’égalité entre les femmes et les hommes, la liberté individuelle, l’affirmation des identités plurielles, l’essor de la création contemporaine ou encore la construction d’un espace public pluraliste sont devenus des évidences largement admises. Ces évolutions irriguent aujourd’hui encore la France et ses Outre-mer, où l’ouverture culturelle et la circulation des idées doivent beaucoup à l’esprit de 68.
L’analyse de Maurice Laouchez éclaire des inquiétudes réelles, mais elle ne doit pas faire oublier ce que Mai 68 a permis : une France plus libre, plus diverse, plus respirante. Une société qui n’a pas seulement contesté, mais qui s’est, dans le même geste, libérée et modernisée.
Gérard Dorwling-Carter