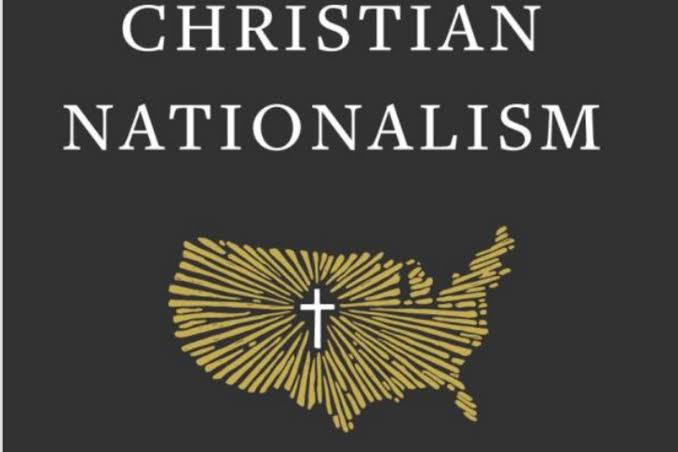Washington – Dans un pays où la séparation de l’Église et de l’État est inscrite au Premier Amendement de la Constitution, la frontière entre religion et politique apparaît de plus en plus poreuse. Sous l’administration du président Donald Trump, le christianisme occupe une place centrale dans le discours officiel, au point d’alimenter un mouvement que ses promoteurs revendiquent ouvertement : le nationalisme chrétien.
La foi au cœur du pouvoir
La commémoration de Charlie Kirk, figure conservatrice proche du président, a donné la mesure de cette imbrication. Présentées par Donald Trump comme « un retour à l’ancienne » plutôt que comme de simples funérailles, les cérémonies se sont transformées en démonstration politico-religieuse. Le président, son vice-président JD Vance, le président de la Chambre des représentants et une grande partie du cabinet ont multiplié les références au christianisme.
Le conseiller Stephen Miller a affirmé que « nous sommes du côté de Dieu ». Le secrétaire d’État, Marco Rubio, a conclu son allocution par un sermon sur la Seconde Venue, tandis que JD Vance saluait en Kirk un « guerrier pour le Christ ». Pour plusieurs observateurs, jamais autant de responsables gouvernementaux n’avaient cité Jésus-Christ aussi explicitement dans un cadre officiel.
Une idéologie en expansion
Au centre de cette dynamique se trouve le nationalisme chrétien, selon lequel les États-Unis auraient été fondés comme une nation chrétienne et que la foi devrait guider la vie publique et les lois. Cette vision, contestée par la majorité des chercheurs, gagne néanmoins du terrain dans la sphère conservatrice.
Donald Trump lui-même en a multiplié les signaux. Quelques jours avant l’assassinat de Kirk, il déclarait au Musée de la Bible, à Washington, que « pour avoir une grande nation, il faut avoir une religion », promettant de protéger la prière à l’école publique. Son administration a mis en place une Commission de la liberté religieuse au sein du ministère de la justice, chargée de dénoncer les supposés biais « anti-chrétiens ».
Des réformes aux accents théocratiques
Cette orientation idéologique se traduit par des mesures concrètes. L’administration fiscale (IRS) a annoncé que les pasteurs soutenant ouvertement des candidats conserveraient leur statut d’exonération. Le Bureau de la gestion et du budget a autorisé les fonctionnaires fédéraux à prêcher sur leur lieu de travail. Au Pentagone, le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a organisé des services de prière pendant les heures de travail.
Ces évolutions nourrissent l’influence de figures comme le pasteur Douglas Wilson, installé en Idaho mais actif à Washington, chef de file assumé du nationalisme chrétien. Proche de M. Hegseth, il se déclare favorable à une théocratie et à la criminalisation de l’homosexualité.
Une société fracturée
Selon le Public Religion Research Institute (PRRI), environ 30 % des Américains adhèrent ou sympathisent avec le nationalisme chrétien, avec des différences régionales marquées : près de la moitié de la population dans le Sud profond (Mississippi, Louisiane, Oklahoma, Alabama), un tiers en Floride et au Texas, moins de 25 % dans les États démocrates.
Cette évolution traduit la polarisation croissante du pays. Alors que l’administration Trump assume un tournant chrétien-nationaliste, une large partie de la société demeure attachée au principe fondateur de la séparation entre l’Église et l’État. Le débat, désormais ouvertement politisé, s’installe au cœur de la campagne et du futur de la démocratie américaine.