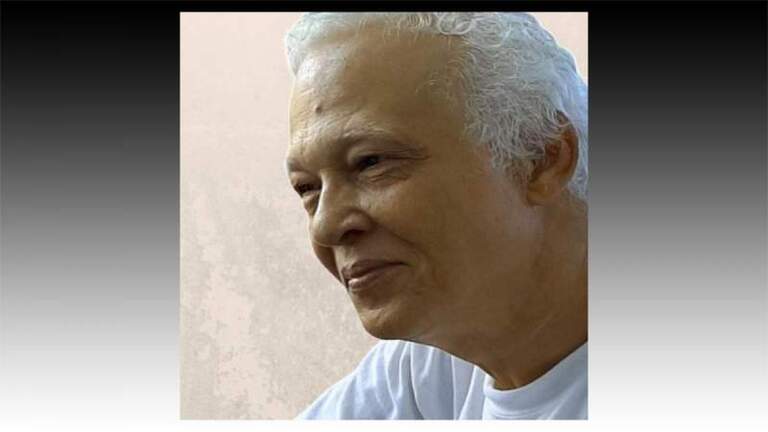Sous couvert de coopération, de transition écologique ou de révolution numérique, le monde assiste au retour insidieux d’une logique impériale. Dans la Caraïbe comme en Afrique, le colonialisme ne s’exprime plus par les canons, mais par la dette, les algorithmes et les réseaux de dépendance.
Le retour du Big Stick dans la Caraïbe
Le spectre d’une diplomatie de la force refait surface dans la région caraïbe, rappelant les heures sombres de la doctrine du Big Stick qui, au début du XXᵉ siècle, permettait aux États-Unis d’imposer leur loi sur leur « arrière-cour ». Aujourd’hui, face au Venezuela et à d’autres nations jugées « rebelles » à l’ordre économique occidental, Washington renoue avec cette logique interventionniste — désormais justifiée au nom des droits de l’homme ou de la lutte contre les trafics.
Derrière cette démonstration de puissance se cache une volonté de reprendre le contrôle d’un espace stratégique convoité : la Caraïbe, riche en hydrocarbures, en ressources minières et en positions géopolitiques clés. Ce qui s’y joue résonne étrangement avec les dynamiques observées sur le continent africain : la domination contemporaine s’exerce moins par la conquête militaire que par l’influence économique, technologique et idéologique.
Un miroir africain : la recolonisation silencieuse
L’Afrique et la Caraïbe sont aujourd’hui les champs de bataille d’une recomposition mondiale où les anciennes puissances, déclinantes, cherchent à préserver leur suprématie. La géopolitique du XXIᵉ siècle se définit par l’action des grandes puissances — Chine, États-Unis, Union européenne, Russie, Inde — qui se partagent la scène mondiale, excluant de facto la Caraïbe et l’Afrique.
Le risque géopolitique actuel pour ces régions atteint un point d’acmé : guerres, terrorisme, tensions économiques et instabilité politique convergent pour remettre au goût du jour la logique de domination.
Derrière le voile de la mondialisation, des discours sur la durabilité ou la coopération, se cache une réalité brutale : celle d’un continent à nouveau soumis à des dynamiques de dépendance et de prédation.
Le néocolonialisme énergétique et technologique
Le colonialisme d’hier, armé de canons et de gouverneurs, a cédé la place à des formes plus subtiles : dépendances financières, accords commerciaux inégaux, contrôle des ressources stratégiques, mainmise technologique.
La compétition mondiale pour le contrôle de l’Afrique s’est intensifiée à mesure que les anciennes puissances coloniales perdaient de l’influence. États-Unis, Chine, Russie, Union européenne, Turquie ou monarchies du Golfe se disputent désormais le « dernier grand réservoir de ressources » du XXIᵉ siècle. Sous prétexte de coopération, d’aide au développement ou de transition énergétique, c’est une véritable guerre économique qui se joue.
La Chine échange infrastructures et prêts contre concessions minières ; la Russie soutient des régimes autoritaires via ses milices ; les États-Unis multiplient les bases militaires sous couvert de lutte antiterroriste ; la France maintient ses intérêts par ses multinationales. Ainsi renaît un néocolonialisme énergétique, où l’abondance devient une faiblesse : plus un pays est riche en ressources, plus il devient vulnérable aux ingérences.
Le colonialisme numérique : l’empire des algorithmes
À la domination économique et militaire s’ajoute désormais une domination technologique. L’intelligence artificielle, nouvelle frontière du pouvoir mondial, consomme chaque jour autant d’énergie que des millions de foyers. Les grandes puissances monopolisent l’accès aux technologies et aux infrastructures numériques, laissant l’Afrique et la Caraïbe dépendantes de systèmes conçus ailleurs.
Cette fracture technologique détermine déjà les emplois, l’éducation, la production culturelle et les imaginaires collectifs. Les géants du numérique — Microsoft, Google, Amazon, Nvidia — ne sont plus de simples entreprises : ce sont des puissances quasi-souveraines façonnant le monde selon leurs intérêts.
Ainsi s’installe un colonialisme numérique, où les nations du Sud deviennent des territoires de consommation et de surveillance, dépendants d’algorithmes étrangers et d’une technologie qu’ils ne maîtrisent pas.
Résister à la dépendance, reconquérir la souveraineté
Le néocolonialisme contemporain ne s’impose plus par la force, mais par la dette, le commerce, la technologie et la manipulation de l’information. Les gouverneurs coloniaux ont été remplacés par des serveurs et des contrats.
Même la rhétorique écologique — pourtant cruciale — peut devenir un outil de domination lorsqu’elle impose aux pays du Sud des modèles inaccessibles tout en exploitant leurs ressources pour la « transition verte » du Nord.
Face à cette réalité, l’Afrique et la Caraïbe sont à un tournant historique. Leur survie passe par la conquête d’une souveraineté technologique et intellectuelle, par l’investissement dans la formation, la recherche et l’innovation locale. La véritable décolonisation du XXIᵉ siècle ne sera pas politique : elle sera numérique, énergétique et cognitive.
Car la recolonisation du monde n’est plus une fiction. Elle se réinvente, fluide, invisible, inscrite dans les câbles, les codes et les algorithmes. Et c’est peut-être là, dans cette discrétion même, que réside le plus grand péril pour les peuples qui n’ont pas encore compris que l’avenir se joue désormais dans la sphère technologique — matrice du pouvoir du siècle nouveau.
Jean-Marie Nol, économiste et juriste en droit public