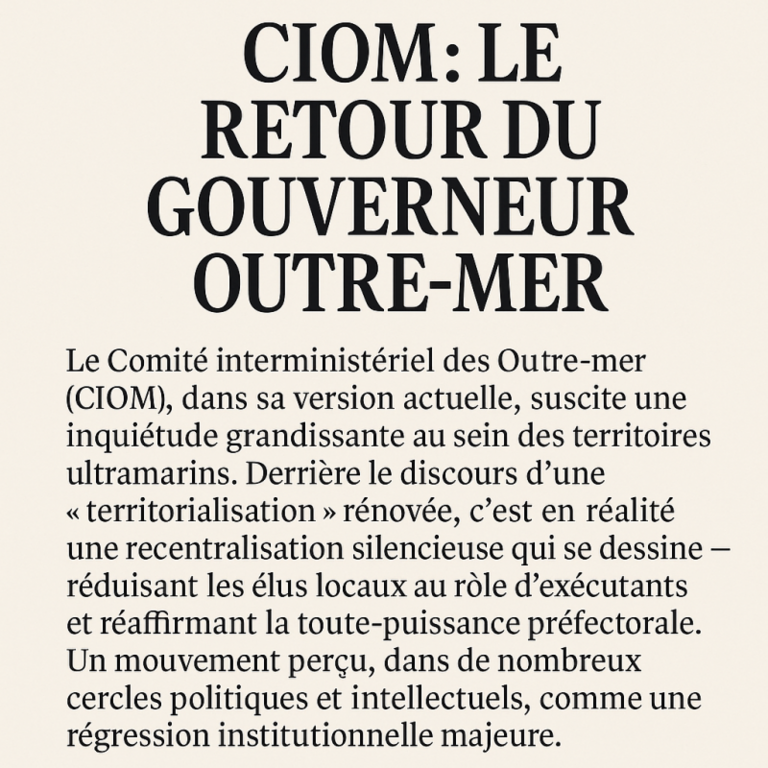Le Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), dans sa version actuelle, suscite une inquiétude grandissante au sein des territoires ultramarins. Derrière le discours d’une « territorialisation » rénovée, c’est en réalité une recentralisation silencieuse qui se dessine, réduisant les élus locaux au rôle d’exécutants et réaffirmant la toute-puissance préfectorale. Un mouvement perçu, dans de nombreux cercles politiques et intellectuels, comme une régression institutionnelle majeure.
Une territorialisation trompeuse
Le terme peut séduire. Il évoque une adaptation des politiques publiques aux réalités de chaque territoire. Mais la territorialisation promue par le CIOM repose essentiellement sur la figure du préfet, représentant de l’État. En réaffirmant son rôle central dans la conduite des projets locaux, l’État donne le signal d’une reprise en main verticale de l’action publique. Les collectivités ne sont plus des co-constructeurs, mais de simples relais d’exécution.
Il ne s’agit pas ici d’un renforcement des compétences locales, mais d’un déplacement du pilotage stratégique hors du champ politique territorial. C’est une recentralisation par la voie administrative, sous couvert de modernisation. Une logique qui ne fait que renforcer la tutelle de l’État au détriment de l’autonomie de décision des élus.
Une rupture avec l’histoire politique des Outre-mer
Ce basculement soulève une question de fond : celle de la reconnaissance des peuples ultramarins comme sujets politiques collectifs. Depuis plus de 70 ans, les territoires d’outre-mer ont mené un combat continu pour une plus grande responsabilisation institutionnelle, nourri par une volonté de codéfinir leur avenir, à partir de leurs propres réalités culturelles, sociales, économiques et historiques.
De nombreuses figures politiques, aux sensibilités variées, ont porté cet idéal : Aimé Césaire, bien sûr, mais aussi Gaston Monnerville, Lucette Michaux-Chevry, Paul Vergès, Claude Lise, Georges Pau-Langevin ou Alfred Marie-Jeanne. Tous ont défendu l’idée d’une République capable de reconnaître la diversité de ses territoires, et de faire place à une véritable capacité de décision locale.
Le CIOM, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, tourne le dos à cet héritage. Il entérine l’idée que les territoires ultramarins seraient inadaptés à l’exercice de la responsabilité politique. Il s’inscrit dans une logique descendante, technocratique, où la planification remplace le débat, et où la stratégie émane exclusivement du sommet de l’État.
Une déconcentration qui remplace la décentralisation
Ce que certains appellent une nouvelle méthode n’est, en réalité, qu’un glissement discret de la décentralisation vers la déconcentration. Les outils changent, mais le pouvoir reste concentré. Il ne s’agit pas d’un partage, mais d’un encadrement. Le risque est clair : que les collectivités soient vidées de leur capacité à initier des politiques, et transformées en opérateurs locaux d’un agenda conçu ailleurs.
Cette logique contribue à une forme d’aliénation institutionnelle. Ce qui était autrefois le ruisseau discret de l’assimilation pourrait devenir un torrent d’effacement politique. En substituant l’État à l’expression des territoires, on prive les populations de leur droit à définir leur propre avenir. On remplace le politique par le protocole, l’émancipation par la gestion.
Une République sous condition
L’enjeu dépasse le seul cadre administratif. Il touche à la nature du pacte républicain. Car si la République ne reconnaît pas à ses territoires ultramarins la même capacité de responsabilité qu’à ses régions hexagonales, alors elle trahit sa propre promesse d’égalité. Elle valide, implicitement, l’idée d’une hiérarchie entre les territoires — entre ceux qui décident, et ceux qui appliquent.
Dans ce contexte, continuer à parler de « projet de territoire » devient une formule vide si les instruments de ce projet ne sont plus entre les mains des élus. Ce qu’expriment aujourd’hui de nombreux acteurs politiques et institutionnels, c’est le refus de cette dérive. Non par goût de la confrontation, mais au nom d’un principe fondamental : les Outre-mer ne peuvent être gouvernés sans eux.
Gérard Dorwling-Carter