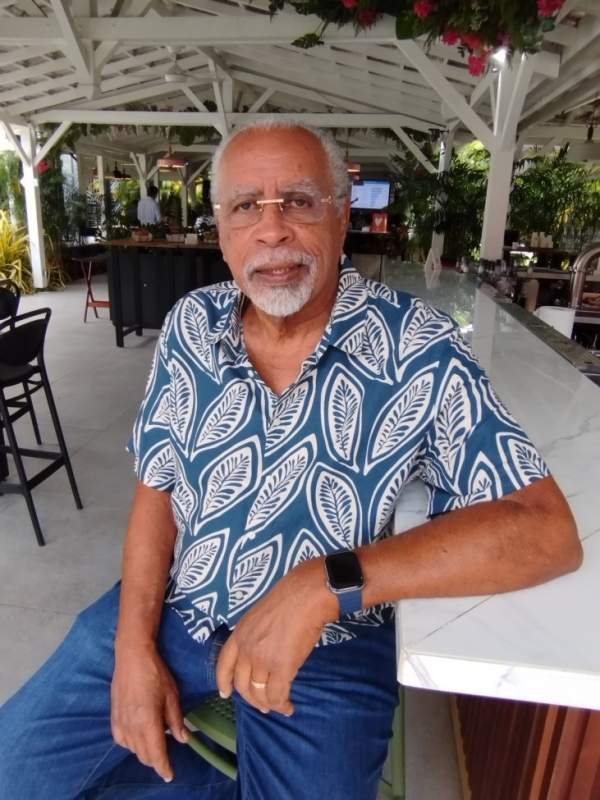Ce que le débat révèle pour la Martinique
François Bayrou privilégie le consensus corse au détriment du Conseil d’État
Le Premier ministre François Bayrou a annoncé soutenir le projet de révision constitutionnelle sur le statut de la Corse dans sa version initiale, telle qu’adoptée par les élus insulaires. Il rejette ainsi les modifications proposées par le Conseil d’État, qui voulait notamment supprimer la référence à une « communauté corse » et refuser un pouvoir législatif autonome à la Collectivité de Corse.
« Je suis favorable à présenter au Parlement le texte qu’ils ont adopté. En règle générale, je suis pour que l’État tienne la parole donnée », a déclaré M. Bayrou.
Le gouvernement entend ainsi honorer un accord politique conclu avec l’ensemble des groupes de l’Assemblée de Corse.
Les inquiétudes du Sénat
Cette position suscite de fortes réticences dans la haute assemblée. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a exprimé ses préoccupations : « Ne pas tenir compte de l’avis du Conseil d’État serait une atteinte grave aux prérogatives du Parlement », a-t-il prévenu dans une lettre adressée au Premier ministre.
Le Conseil d’État s’oppose à ce que la Corse puisse voter des lois sans contrôle du Parlement national, et juge dangereuse la reconnaissance juridique d’une « communauté » corse.
Un précédent institutionnel surveillé en Outre-mer
En Martinique, ce débat n’est pas sans résonance. Depuis la création de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) en 2015, les discussions sur l’évolution institutionnelle, voire sur l’autonomie, reviennent régulièrement dans le débat public.
La volonté exprimée par les élus corses d’obtenir une autonomie législative relance la question : et nous, en Martinique, jusqu’où voulons-nous aller dans la différenciation ?
Un dialogue entre Paris et les territoires sous tension
Le gouvernement a choisi de préserver le fragile consensus obtenu en Corse, notamment avec les nationalistes de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif. Ce dernier a averti que l’échec du projet d’autonomie pourrait « ouvrir la porte à des décennies d’incertitudes ». Une déclaration dénoncée par certains élus corses comme une forme de chantage politique.
François-Xavier Ceccoli, député de Haute-Corse, a mis en garde : « On ne peut pas laisser les élus faire la loi en Corse sans supervision, alors que la société est encore marquée par des réseaux d’influence et de pression. »
Martinique : un débat en suspens
En Martinique, le débat sur l’autonomie reste souvent éclipsé par les urgences sociales, économiques et environnementales. Pourtant, les limites du modèle actuel sont régulièrement pointées : compétence restreinte de la CTM, centralisation persistante, absence d’un véritable pouvoir normatif local.
Le cas corse interroge : faut-il attendre une crise pour que l’État accepte d’ouvrir un véritable processus de dialogue institutionnel avec les territoires d’Outre-mer ? Les Martiniquais ont-ils suffisamment confiance en leurs élus pour vouloir que plus de pouvoirs leurs soient conférés? Ont-ils la l’intime conviction que l’État Français ne profitera pas de l’occasion pour abandonner le territoire en appliquant le principe que c’est celui qui paie qui commande?
Vers un nouveau pacte entre République et territoires ?
La décision finale revient au président Emmanuel Macron. D’ici quelques jours, il devra trancher : intégrer ou non les recommandations du Conseil d’État dans le projet de loi sur l’autonomie corse.
Quelle que soit son choix, l’enjeu dépasse la seule île de Beauté. Il s’agit de redéfinir le pacte républicain avec les territoires à forte identité. La Martinique, comme la Guadeloupe ou la Guyane, pourrait bien se retrouver à la croisée des chemins dans les années à venir. Dès jours incertains sont à prévoir.
Gérard Dorwling-Carter