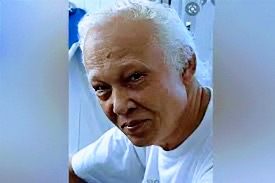.Dans le débat actuel sur l’autonomie des territoires ultramarins, la question des réparations liées à l’esclavage et à la colonisation s’entrelace avec une problématique identitaire, juridique et politique plus vaste : celle du principe de précaution appliqué à une responsabilité locale accrue. Cette combinaison peut, si elle est mal pensée, se transformer en un piège redoutable : transférer aux collectivités ultramarines la charge morale et juridique de réparer des injustices historiques responsables de l’actuel mal-développement, tout en les privant des moyens financiers et institutionnels nécessaires pour y parvenir.
Réparations : un débat inabouti
La loi Taubira de 2001 a reconnu l’esclavage comme crime contre l’humanité. Mais aucune procédure claire de réparation matérielle n’a été instituée. Les demandes financières – comme celle des 200 milliards d’euros formulée par le Mouvement international des réparations en 2005 – se sont heurtées à l’impossibilité juridique d’évaluer avec précision les préjudices subis. Ce blocage nourrit un sentiment d’injustice et de frustration.
Le principe de précaution : outil ou piège ?
Dans ce contexte, le maintien du cadre de l’article 73, présenté comme protecteur, est souvent perçu comme une précaution. Mais transposer l’article 74 pour des raisons idéologiques expose au risque d’un immobilisme institutionnel. En effet, le principe de précaution, détaché de la notion de faute, peut aboutir à une gouvernance locale paralysée par la peur d’agir, plutôt qu’animée par l’innovation. Une autonomie sans moyens budgétaires conséquents ne serait qu’un fardeau, renforçant les inégalités au lieu de les corriger.
Réparer au-delà du financier
L’expérience historique montre que la réparation ne peut se limiter à une indemnisation monétaire. Elle doit s’attaquer aux héritages sociaux de l’esclavage : mal-développement, inégalités structurelles, discriminations persistantes, fractures mémorielles. Cela suppose des politiques ambitieuses d’éducation, de formation, d’accès à la propriété et de reconnaissance culturelle. Or, une autonomie vidée de ressources pérennes ne ferait qu’exacerber les carences de l’État et fragiliser la cohésion sociale.
Quand la précaution devient paralysie
Appliqué de façon rigide, le principe de précaution peut figer l’action publique. Dans des territoires déjà fragilisés, il risque de bloquer les investissements indispensables à la réduction des inégalités héritées de l’esclavage. L’autonomie risquerait alors de se transformer en piège juridique et politique : responsabilité accrue mais fictive, budgets exsangues, ponctions fiscales sur une classe moyenne déjà fragilisée.
Quelle autonomie ?
Deux options se dessinent :
- une autonomie proclamée dans le cadre de l’article 74, instable et sans moyens suffisants, qui condamnerait les élus à gérer l’impossible ;
- ou une autonomie concertée, fondée sur la refonte de l’article 73, accompagnée d’un véritable plan de réparation et de transferts massifs de l’État, alliant mémoire, justice sociale et développement économique.
La première mène à l’impasse. La seconde suppose un engagement clair de l’État à financer durablement la réduction des inégalités.
La mémoire, pilier de la réparation
Le travail de mémoire ne peut se substituer à la justice sociale, mais il reste incontournable. La France accuse un retard dans ce domaine : peu de lieux consacrés à l’histoire de l’esclavage existent, hormis le Mémorial ACTe en Guadeloupe. La création d’un grand musée en Guadeloupe, la multiplication d’espaces de réflexion, l’appui à la recherche et à la médiation culturelle permettraient de dépasser le rapport accusatoire et de donner un usage thérapeutique à la mémoire.
Conclusion : éviter le néo-colonialisme par l’illusion
Une responsabilité sans moyens est une responsabilité fictive. Elle produit frustration, divisions et défiance envers les institutions locales. La combinaison « réparations–autonomie–précaution », mal pensée, risque de devenir l’archétype du néo-colonialisme : une autonomie illusoire, sans maîtrise réelle du destin économique et social.
La réparation véritable ne se décrète pas. Elle se construit dans la durée, par un engagement politique clair, un financement durable et un dialogue sincère entre l’État, les collectivités et la société civile.
« Fo pa nou pwan dlo mousach pou lèt » – il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes.
Jean-Marie Nol, économiste et chroniqueur