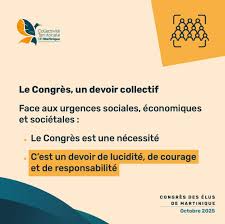Par Gérard Dorwling-Carter
Le mot autonomie a longtemps fait peur. Il a évoqué, selon les époques, la rupture, la défiance ou la nostalgie des combats d’hier. Mais en 2025, à la lumière des débats du Congrès des élus de Martinique, il prend un sens profondément nouveau : celui de la responsabilité partagée. Être autonomiste aujourd’hui, ce n’est plus revendiquer la séparation. C’est affirmer que la Martinique doit se gouverner davantage elle-même, au sein de la République, en adaptant les politiques publiques à sa réalité insulaire.
La domiciliation du pouvoir normatif
Le 8 octobre 2025, les élus martiniquais ont voté à l’unanimité une résolution pour la domiciliation du pouvoir normatif local. Derrière cette formule juridique, une idée simple : permettre à la Martinique de faire ses propres règles dans les domaines où elle a compétence — sans dépendre systématiquement des décisions de Paris. Il ne s’agit pas d’indépendance, mais d’une autonomie d’adaptation, un modèle médian entre les articles 73 et 74 de la Constitution. Un modèle qui reconnaît la spécificité martiniquaise tout en restant fidèle au cadre républicain.
L’autonomie comme levier de développement
L’autonomie n’est pas une fin idéologique. C’est un moyen de transformer le modèle économique et social du pays. Elle permettrait de repenser les politiques publiques en fonction des réalités locales : relancer la production agricole, réguler le coût de la vie, soutenir les jeunes entrepreneurs, encourager la culture et l’innovation. L’autonomiste contemporain est en quête d’une Martinique qui produit, crée et décide, plutôt que de subir. C’est une autonomie économique et culturelle avant d’être institutionnelle.
Une culture de la responsabilité
L’autonomie suppose de la rigueur et de la transparence. Être autonomiste, c’est assumer nos propres choix, ne plus tout attendre de l’État, et cesser d’attribuer nos échecs à la seule distance géographique ou à l’héritage colonial. Cette responsabilité ne se limite pas aux élus : elle concerne aussi la société civile, les syndicats, les entreprises, les associations. C’est un appel à la maturité politique et citoyenne — celle d’un peuple qui veut se prendre en main. Sinon elle ne fonctionnera pas.
Refonder le lien avec la République
L’autonomie n’est pas une rupture, mais une réinvention du contrat républicain. Elle propose une nouvelle relation : de la dépendance à la co-responsabilité, de la tutelle à la confiance. La Martinique veut être reconnue comme partenaire de la France, avec ses spécificités, ses compétences et sa dignité. Ce n’est pas une revendication contre, mais une ambition pour : celle d’une République capable d’épouser la diversité de ses territoires.
Un choix d’avenir
Être autonomiste à la Martinique, aujourd’hui, c’est refuser le statu quo. C’est croire que la démocratie locale doit disposer de ses propres leviers pour répondre à ses défis : la démographie, l’économie, l’écologie, l’identité. C’est, en somme, choisir la responsabilité plutôt que la dépendance, et croire encore à cette promesse républicaine : qu’un peuple peut être pleinement lui-même, tout en restant partie d’un ensemble plus grand.
Le 14 octobre 2025