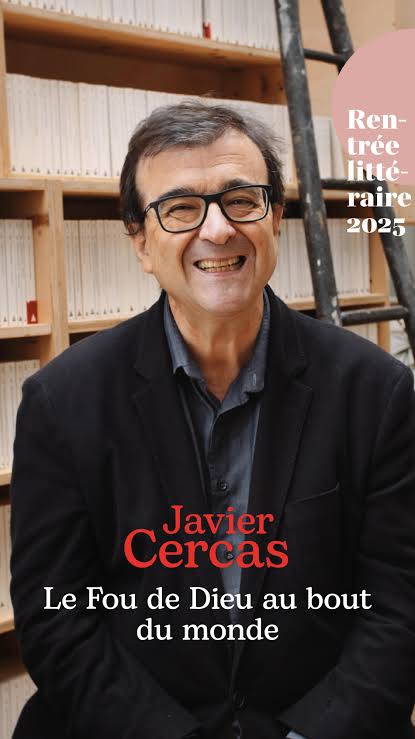Le Vatican a sollicité l’écrivain espagnol Javier Cercas pour relater un voyage officiel du pape François. Une mission singulière, à la fois politique, spirituelle et littéraire.
L’athée convoqué par Rome
Dieu aurait-il le sens de l’humour ? Lorsque, en mai 2023, Javier Cercas reçoit un appel du Vatican lui proposant d’accompagner le pape François lors de son déplacement en Mongolie, l’auteur de Soldats de Salamine croit d’abord à une plaisanterie. « Mais vous savez que je suis un homme dangereux ? », s’amuse-t-il à répondre à ses interlocuteurs. Farouchement laïc, volontiers provocateur, le romancier espagnol, connu pour ses enquêtes sur la mémoire historique et les ambiguïtés morales du pouvoir, se retrouve soudain investi d’une mission diplomatique et spirituelle inattendue.
Pour cet écrivain qui s’est toujours méfié des institutions religieuses, l’expérience tourne à la méditation existentielle.
Cercas n’a accepté qu’à une seule condition : pouvoir poser une question intime au souverain pontife, une interrogation qui le hante depuis l’enfance. Sa mère, catholique fervente, reverra-t-elle un jour son mari défunt dans l’au-delà ? Cette promesse de dialogue entre le « fou sans Dieu » et le « fou de Dieu » devient le fil rouge du livre — une quête où se rejoignent la foi, la raison et la littérature.
Un voyage intérieur sous le signe du doute
De cette rencontre improbable est né un récit surprenant, à la frontière entre reportage, confession et roman philosophique. Dans Le Pape et l’athée, Cercas raconte son périple à travers la steppe mongole, dans les pas d’un François affaibli mais habité par une énergie spirituelle inépuisable. L’auteur y explore le Vatican comme un théâtre d’hommes cultivés, lucides, passionnés, loin des clichés du pouvoir religieux.
« Ce n’est pas un thriller ésotérique à la Dan Brown, confie-t-il. Pas de malédiction ni de complot, mais des discussions sur la mort, la vérité et le mystère de la foi. »
Le livre, pétri d’humour et d’intelligence, mêle journal de bord et réflexion morale. « L’effort le plus grand que j’ai fourni, c’est de me débarrasser de mes préjugés », avoue Cercas.
« Je voulais aborder les questions éthiques et politiques avec transparence et passion. Si tu n’arrives pas à rendre la complexité compréhensible, c’est que tu ne la comprends pas. »
De la mémoire historique à la métaphysique
Depuis ses débuts, Javier Cercas écrit contre les simplifications. Dans Les Soldats de Salamine, il ressuscitait la guerre civile espagnole pour interroger la frontière entre héroïsme et mensonge ; dans L’Imposteur, il disséquait la figure de l’écrivain comme usurpateur de vérité. Cette fois, il s’attaque, dit-il, à « l’énigme des énigmes : celle de la résurrection de la chair et de la vie éternelle ».
Ce n’est pas un hasard si, sur les routes de Mongolie, l’auteur cite Nietzsche, Montaigne, mais aussi Borges et Unamuno — autant de penseurs qui ont fait de la foi une question de style et de vertige intellectuel.
Entre scepticisme et espérance
Derrière sa curiosité rationaliste perce une tendresse désarmante pour la spiritualité qu’il croyait détester. Loin de convertir l’écrivain, le pape François lui apprend surtout à écouter. « Il ne m’a pas convaincu, mais il m’a ébranlé, confie Cercas. Peut-être que croire, c’est simplement continuer à poser des questions sans attendre de réponses définitives. »
Dans les dernières pages, (Le fou de Dieu au bout du monde (Actes Sud) la fameuse interrogation sur la vie après la mort trouve enfin sa réponse — non pas théologique, mais littéraire. Et Cercas, l’athée, conclut : « J’ai compris qu’entre la foi et la fiction, il n’y a peut-être qu’une seule différence : l’espérance. »
Jean-Paul BLOIS