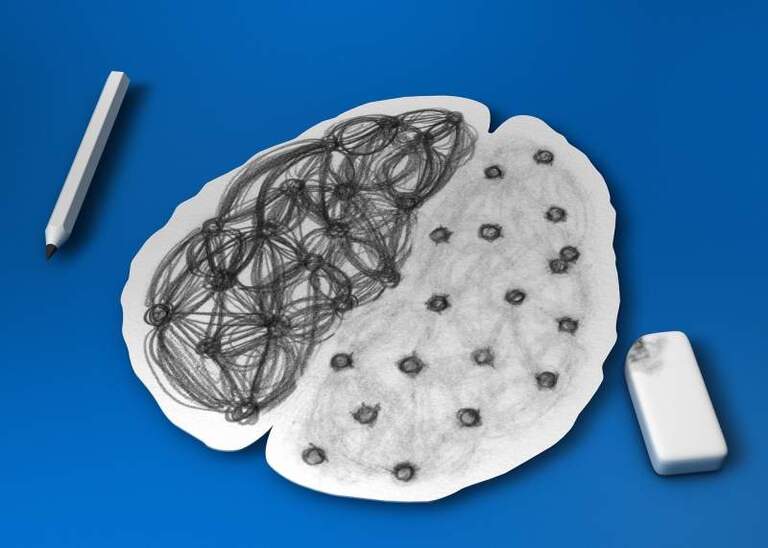En Martinique, plus de 9 000 personnes vivent avec Alzheimer. Face à une population vieillissante et à la précarité des aidants, la Journée mondiale Alzheimer rappelle l’urgence : transformer l’émotion en action, pour inventer prévention, inclusion et solidarité.
Trois jours par semaine, j’accompagne ma mère. Comme des milliers d’aidant.e.s martiniquais.e.s, je vois la courbe du temps s’inverser autour de nous : plus de personnes âgées que de jeunes, plus de décès que de naissances, et une jeunesse qui s’en va étudier ailleurs, mais revient trop rarement. Cette réalité démographique, ajoutée aux départs, fait de la Martinique un territoire particulièrement exposé à la progression de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés.
Un chiffre, une urgence
Dans le monde, toutes les trois secondes, une personne développe une démence. Selon l’OMS, plus de 55 millions de personnes vivent aujourd’hui avec ces pathologies, un nombre appelé à tripler d’ici 2050. Le coût mondial dépassait déjà 1,3 trillion de dollars en 2019, dont près de la moitié supportée par les familles aidantes. Malgré quelques avancées récentes, aucun traitement curatif n’existe encore.
En Martinique, on estime à 9 000 le nombre de personnes vivant avec Alzheimer ou une maladie apparentée, et à plus de 500 le nombre de nouveaux cas chaque année. Dans un territoire de 350 000 habitants, où plus d’un tiers de la population a plus de 60 ans, ce défi est colossal.
Un euro investi en prévention, c’est des années de qualité de vie préservée et autant de dépenses évitées demain pour traiter une maladie pour laquelle, malgré les progrès scientifiques, nous n’avons toujours pas trouvé de cure.
Les causes : élargir le champ des recherches
La recherche doit avoir le courage d’explorer toutes les pistes : alimentation ultra-transformée, polluants industriels et pesticides, exposition chronique aux ondes… mais aussi traumatismes psychologiques et chocs émotionnels.
Les études récentes le confirment :
- Les traumatismes de vie (violences, viols, maltraitances, blessures graves) augmentent le risque de démence à long terme.
- Le stress chronique et la dépression sont des cofacteurs majeurs.
- Les adversités vécues dans l’enfance (abus, négligence) accroissent la vulnérabilité aux maladies neurodégénératives.
Ces pistes ne peuvent plus être marginales. Elles doivent être intégrées aux financements de la recherche, avec transparence et coopération internationale.
Prévention et inclusion : investir dans la qualité de vie
Nous savons qu’il est possible de réduire une part du risque par l’alimentation, l’activité physique, la stimulation cognitive, la santé mentale et la lutte contre l’isolement. La prévention doit être une politique publique structurante, pas un supplément de discours.
Et l’inclusion n’est pas une utopie :
- À Singapour, les Therapeutic Gardens offrent des parcours ludiques et colorés adaptés aux troubles cognitifs.
- Au Royaume-Uni, les Dementia Friendly Communities adaptent signalétique et espaces publics.
- Aux Pays-Bas, le village Hogeweyk permet de « vivre avec » Alzheimer dans un cadre normalisé, loin des institutions fermées.
Ces initiatives montrent la voie. Pourquoi pas chez nous ?
La double peine des femmes et la précarité des seniors
Les femmes sont en première ligne : elles assurent 71 % des heures d’aide informelle et sont aussi plus nombreuses à être touchées par la maladie. Beaucoup réduisent ou arrêtent leur activité professionnelle pour accompagner leurs proches. Résultat : une perte de revenus, une paupérisation silencieuse des familles, et un ralentissement économique pour le territoire.
Ajoutons la précarité des seniors martiniquais : plus de 30 % vivent sous le seuil de pauvreté. Une population qui consomme moins, investit moins, et dont les besoins croissants pèsent sur une population active déjà réduite. Alzheimer est donc aussi un enjeu économique et social.
Une cause locale, nationale et mondiale
Les maladies d’Alzheimer et apparentées doivent être déclarées Grande cause nationale en France et dans les Outre-mer. Car elles ne sont pas seulement un défi médical : elles touchent à la justice sociale, à la cohésion des familles, à la vitalité de l’économie.
Déclarer Alzheimer Grande cause nationale, c’est :
- Sanctuariser les budgets de recherche et de prévention.
- Coordonner État, collectivités, associations et chercheurs.
- Changer le regard : passer de la fatalité à l’action collective.
Et c’est aussi rejoindre la mobilisation internationale portée par l’OMS et Alzheimer’s Disease International, qui rappellent que ce défi transcende les frontières.
La Martinique, territoire pilote
La Martinique peut et doit devenir l’un des territoires pilotes dans le monde. Parce qu’elle concentre les réalités démographiques du futur (vieillissement, exode des jeunes, ralentissement économique). Parce qu’elle peut expérimenter à échelle réduite des politiques publiques innovantes : observatoire Alzheimer caribéen, parcs thérapeutiques, habitats inclusifs, droits renforcés pour les aidants, projets intergénérationnels.
Nous avons l’opportunité de montrer qu’un petit territoire peut devenir un modèle, dans la Caraïbe et bien au-delà. Utilisons les fonds issus des accords entre l’Union Européenne et la Communauté des États Latino-américains et des Caraibes (UE-CELAC) pour développer conjointement l’espace commun de la recherche selon quatre piliers : Mobilité des chercheurs, Coopération entre les infrastructures de recherche, Défis mondiaux et Innovation.
La Journée mondiale Alzheimer n’est pas une commémoration. C’est un appel : transformer l’émotion en action, ici et partout. Car accompagner Alzheimer, ce n’est pas seulement une affaire médicale. C’est un combat de civilisation.
Un territoire, une République, une humanité se jugent à la manière dont elles traitent leurs plus vulnérables. La Martinique peut choisir de montrer la voie.
Sandra Casanova, Aidante familiale et Présidente de la Commission Politique de la Recherche et de l’innovation à la Collectivité Territoriale de Martinique