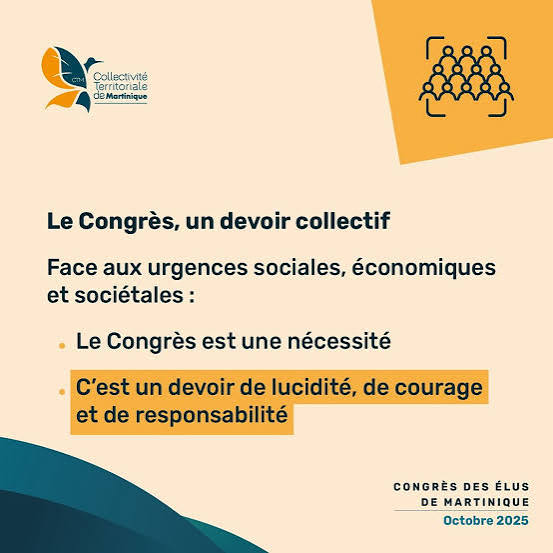À la veille du Congrès des élus de Martinique, deux voix intellectuelles dominent le débat public : celle du politologue Justin Daniel et celle du chroniqueur Gérard Dorwling-Carter, auteur du “Regard de GDC” dans le magazine Antilla. L’un et l’autre dressent un constat sans complaisance : le modèle martiniquais hérité de la départementalisation est à bout de souffle. Mais leurs diagnostics convergents dessinent des voies de sortie aux tonalités différentes.
Le modèle martiniquais en fin de vie
Pour Justin Daniel, la Martinique traverse une “fin de cycle” historique. Le système socio-économique issu de la départementalisation, fondé sur les transferts publics, l’incitation fiscale et la redistribution sociale, ne peut plus fonctionner. “L’État-providence est en crise, la dette et les déficits en limitent désormais la portée. Il faut repenser le modèle au-delà du pouvoir normatif”, prévient-il.
Gérard Dorwling-Carter partage le diagnostic. Dans ses chroniques pour Antilla, il rappelle que l’économie martiniquaise demeure “sous perfusion budgétaire”, incapable de générer une croissance endogène durable. Mais pour lui, cette fin de cycle impose moins un constat qu’un sursaut collectif : “Nous devons oser le changement, dans la clarté, avec des objectifs mesurables et un calendrier lisible.”
Le congrès des élus : entre lucidité et utilité
Les deux observateurs convergent également sur la portée ambiguë du Congrès des élus. Justin Daniel constate une “banalisation” de l’exercice : réunions à répétition, résolutions sans effet, et un fossé croissant entre les attentes citoyennes et les débats institutionnels.
Dorwling-Carter adopte une lecture plus pragmatique : le Congrès ne doit pas être qu’une “affaire de juristes ou de techniciens”, mais aussi un espace d’impulsion politique capable de fédérer les élus, les chambres consulaires, les syndicats et la société civile. Il appelle à “un Congrès de clarté et d’action, où la pédagogie institutionnelle précède les querelles de statut”.
Autonomie : le pouvoir normatif, et après ?
Sur le terrain institutionnel, la nuance est nette.
Justin Daniel se montre prudent : il met en garde contre une focalisation exclusive sur le “pouvoir normatif autonome”, concept souvent invoqué sans contenu concret. “L’autonomie ne se décrète pas par les textes. Elle se construit par la production locale, la responsabilité et la confiance collective.”
Dorwling-Carter, au contraire, revendique ce pouvoir normatif comme outil d’efficacité publique. Il y voit la condition d’une adaptation du droit martiniquais aux réalités du territoire : fiscalité, vie chère, production agricole, emploi. Mais il insiste : ce pouvoir doit être encadré, partagé et progressif, un moyen, non une fin.
Les voies de la reconstruction
L’un et l’autre appellent à une refondation du modèle martiniquais sur des bases endogènes :
- Autonomie économique et alimentaire, pour réduire la dépendance aux importations ;
- Mobilisation du capital local, aujourd’hui sous-exploité ;
- Relance de la confiance civique, condition préalable à toute réforme institutionnelle.
Justin Daniel met l’accent sur la “coconstruction” entre citoyens, élus et État, à inscrire dans une logique franco-européenne. Dorwling-Carter, lui, prône une “feuille de route ” issue du Congrès, traduisant les résolutions en chantiers concrets : eau, transports, numérique, production locale.
Deux voix, un même impératif
Au fond, leurs analyses se rejoignent sur l’essentiel : l’ère des incantations statutaires est révolue.
L’autonomie, disent-ils chacun à leur manière, ne se mesure pas à la rédaction d’un nouvel article constitutionnel, mais à la capacité collective de transformer les contraintes en leviers d’action.
L’un apporte la rigueur universitaire, l’autre la fibre civique et la culture du terrain. Ensemble, ils rappellent que la Martinique ne manque pas de diagnostics. Elle manque encore d’un projet cohérent, porté par tous.
Jean-Paul Blois