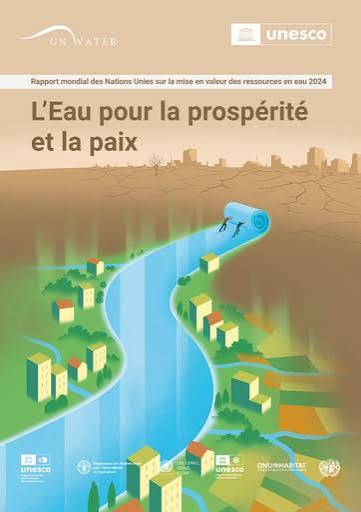Par Jean-Paul BLOIS
Dans les territoires d’Outre-mer, l’eau potable reste un défi structurel. Derrière les paysages tropicaux se cache une réalité complexe : réseaux vétustes, pertes massives, inégalités d’accès et risques sanitaires. De la Guadeloupe à La Réunion, en passant par la Guyane, Mayotte et la Martinique, l’approvisionnement en eau illustre les fragilités profondes des infrastructures publiques ultramarines et la difficulté de garantir un droit fondamental à l’eau sur l’ensemble du territoire français.
Des réseaux vieillissants et des pertes colossales
Selon un rapport conjoint de l’Office français de la biodiversité (OFB) et du ministère des Outre-mer (2024), les fuites représentent entre 35 % et 70 % de l’eau produite dans certains territoires ultramarins, contre 20 % en moyenne dans l’Hexagone. En Guadeloupe, près de 60 % de l’eau potable se perd dans les canalisations ; en Martinique, ce taux atteint encore 40 %, malgré les investissements du Plan eau DOM lancé en 2020. À Mayotte, les coupures quotidiennes sont devenues une norme, révélant une crise structurelle de la ressource. À La Réunion, les épisodes comme celui de Saint-Benoît en octobre 2025 rappellent la vulnérabilité des forages et pompes, souvent obsolètes ou mal interconnectés.
Une gouvernance éclatée et sous-financée
La question de l’eau en Outre-mer est avant tout une crise de gouvernance. Les collectivités locales, souvent sous contrainte budgétaire, peinent à renouveler leurs réseaux. Les syndicats intercommunaux tels que le SIAEAG (Guadeloupe), l’ODISEA (Martinique) ou la CISE Réunion, manquent de moyens humains et techniques. L’État a reconnu « une situation indigne de la République » et lancé plusieurs plans : le Plan Eau DOM (2020-2027), doté de 250 millions d’euros, la Mission d’appui technique de l’OFB, et la mobilisation de fonds européens FEDER et FEADER. Mais les résultats tardent à se concrétiser : seulement 30 % des investissements prévus entre 2021 et 2024 ont été effectivement engagés.
L’eau, miroir des inégalités territoriales
Le manque d’eau potable dans certaines communes ultramarines est le symptôme d’un déséquilibre structurel entre la France hexagonale et ses territoires éloignés. L’accès à l’eau, censé être un droit universel, devient une question d’équité républicaine et de justice sociale. Dans les Antilles, la défiance est forte après les crises du chlordécone et de la pollution des nappes phréatiques. À Mayotte, la crise hydrique de 2023-2024 a révélé un risque humanitaire sur fond de croissance démographique accélérée. Ces crises locales traduisent un même phénomène : la dépendance à des infrastructures sous-dimensionnées et l’absence de planification à long terme.
Vers une stratégie de résilience hydrique
La réponse passe par une vision d’ensemble : réhabiliter les réseaux via des investissements pluriannuels, renforcer la gestion intercommunale, sécuriser les forages et créer des interconnexions entre bassins versants, développer la réutilisation des eaux usées traitées (REUT), diversifier les sources (dessalement, récupération des eaux de pluie) et impliquer la population dans la gestion participative de l’eau. La CTM et la Région Réunion ont déjà intégré ces objectifs dans leurs schémas de transition écologique.
Un enjeu de souveraineté écologique
L’eau devient un enjeu de souveraineté pour les Outre-mer. Assurer l’autonomie hydraulique, c’est garantir la sécurité alimentaire, la santé publique et la résilience face au changement climatique. Les sécheresses plus fréquentes, la pression touristique et la croissance urbaine accentuent la nécessité d’une gestion préventive, locale et équitable des ressources. Comme le souligne un rapport du CESECEM (2025) : « La gestion de l’eau conditionne l’avenir des sociétés ultramarines. Sans politique intégrée, la dépendance à l’Hexagone et la vulnérabilité climatique se renforceront. »
Conclusion : l’eau, un test démocratique
Garantir à chaque citoyen ultramarin un accès continu à l’eau potable n’est plus seulement un objectif technique ou budgétaire : c’est une exigence démocratique. De la réparation d’une pompe à Saint-Benoît à la rénovation du réseau de Gourbeyre, chaque coupure d’eau interroge le sens même de l’égalité républicaine dans les Outre-mer.
— Les chiffres clés de l’eau Outre-mer (2025)
|
Indicateur |
Valeur estimée 2025 |
|
Taux moyen de fuite |
45 à 70 % selon les territoires |
|
Durée moyenne des coupures |
6 à 24 heures par incident |
|
Population concernée par des restrictions annuelles |
1,3 million d’habitants |
|
Part des réseaux de plus de 40 ans |
60 % |
|
Montant du Plan Eau DOM (2020-2027) |
250 millions d’euros |