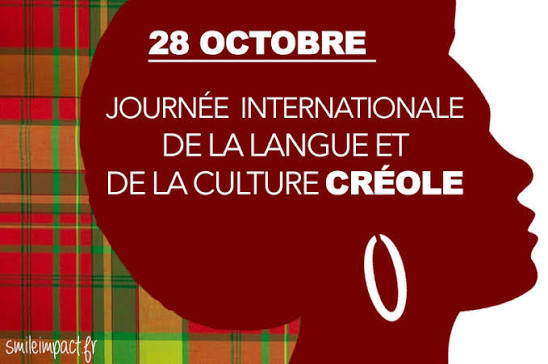Le 28 octobre, la Martinique célèbre la Journée internationale de la langue et de la culture créoles
Née dans la douleur de l’esclavage, la langue créole s’est muée en symbole de dignité et de fierté collective. Chaque 28 octobre, la Martinique, aux côtés de tout le monde créolophone, célèbre la richesse et la vitalité de cette parole libre, porteuse de mémoire et d’avenir.
Une journée née aux Seychelles, célébrée dans tout le monde créole
C’est en 1983, à Victoria, capitale des Seychelles, que s’est tenue la première Conférence internationale des créolophones. De cette rencontre historique est née la Journée internationale du créole, fixée au 28 octobre. Depuis, cette date réunit les peuples de l’arc caribéen, de l’océan Indien, du Cap-Vert ou encore de Louisiane, autour d’un même héritage linguistique et culturel.
« Le créole n’est pas un patois, c’est une langue à part entière, le fruit de l’histoire et du génie populaire », rappelle l’écrivain Raphaël Confiant, co-auteur du Manifeste pour la créolité (1989).
Lang nou sé nou ! Une langue née de la résistance
Née sur les plantations esclavagistes du XVIIᵉ siècle, la langue créole fut d’abord un outil de survie et de résistance. Dans un monde où la parole de l’esclave était interdite, le créole a permis de penser, rire, chanter et aimer malgré l’oppression.
« Le créole est une conquête de liberté. C’est le premier espace de souveraineté du peuple antillais », expliquait Jean Bernabé, linguiste martiniquais et fondateur du GEREC (Groupe d’Études et de Recherches en Espace Créolophone).
Une langue d’art, de scène et de savoir
Aujourd’hui, le créole résonne partout : dans les chansons de Kassav’, les poèmes de Monchoachi, les chroniques de Georges Mauvois, ou les slams de la jeune génération. Il s’écrit, se chante, se crie. De la salle de classe aux scènes du monde, il s’impose comme une langue d’art et de savoir.
L’Université des Antilles, la CTM, et plusieurs associations culturelles, telles que KM Kréyol, Aka Fanm, ou Lang épi Lavi, organisent ce week-end des lectures, projections et ateliers pour célébrer cette langue « ka palé an tjè nou ».
Un combat toujours actuel : le créole à l’école et dans la cité
Malgré les progrès accomplis, le créole reste fragile face à la domination du français. Son enseignement demeure inégal, et sa reconnaissance institutionnelle encore timide.
« Le créole doit entrer pleinement dans la citoyenneté. On ne peut pas construire une société confiante dans une langue que l’on méprise », plaide un enseignant du pôle Martinique de l’Université des Antilles.
Des projets de traduction administrative et de formation bilingue voient le jour, mais leur généralisation dépend encore d’une volonté politique forte.
Une langue d’avenir dans le monde numérique
Longtemps cantonné à l’oralité, le créole fait désormais son entrée dans le monde numérique : applications d’apprentissage, podcasts, Wikipédia en créole, traduction automatique, et même interfaces d’intelligence artificielle. Le créole martiniquais devient une langue du XXIᵉ siècle, capable de s’adapter à tous les espaces de communication.
« Sé nou ka palé, sé nou ka viv »
Plus qu’une langue, le créole est un pays d’âme, un territoire de mémoire et d’invention. Célébrer sa journée, c’est affirmer la force d’un peuple qui, à travers les siècles, a su transformer la domination en culture, et la douleur en parole.
« Lang nou sé nou ! » — Notre langue, c’est nous.