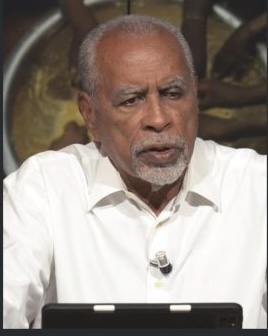La Martinique aspire, selon ses élus, à davantage de responsabilités politiques et économiques. Certains y voient une menace pour l’unité nationale. Et si c’était l’inverse ? Si, loin de remettre en cause les principes de la République, cette exigence les rendait plus nécessaires que jamais, à condition de les rendre effectifs dans des sociétés fragilisées par les inégalités et la mémoire coloniale ?
Une égalité proclamée, mais trahie
Les Antillais sont citoyens français à part entière. Pourtant, dans la réalité, l’écart demeure béant : chômage des jeunes dépassant les 30 %, coût de la vie supérieur d’un tiers à celui de la métropole, hôpitaux en crise permanente.
À cela s’ajoute le scandale du chlordécone, pesticide interdit ailleurs mais utilisé pendant des décennies aux Antilles, contaminant terres et organismes. Ce drame sanitaire et environnemental, reconnu mais jamais pleinement réparé, illustre une égalité proclamée mais non vécue. Ici, l’égalité républicaine se vit comme une promesse trahie.
Une liberté confisquée par l’éloignement du pouvoir
La liberté politique ne se mesure pas seulement au droit de voter, mais à la capacité d’influer sur les choix collectifs. Or, aux Antilles, les décisions essentielles – prix, fiscalité, santé, éducation – sont arrêtées à Paris. Résultat : une abstention massive, parfois au-delà de 70 %, comme aux européennes de 2024 en Martinique.
À cette distance institutionnelle s’ajoute une défiance envers des élus locaux jugés impuissants face au quotidien. Le mouvement social de 2021 contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale des soignants a révélé ce rejet d’un pouvoir central perçu comme autoritaire et déconnecté.
Demander plus de responsabilités locales, c’est exiger une liberté réelle : celle de décider pour soi. C’est aussi mettre les élus face à leurs responsabilités, sans l’alibi commode du manque de pouvoir décisionnel.
Une fraternité érodée par l’abandon
La fraternité suppose solidarité et protection. Or, les sociétés antillaises connaissent des fractures sociales profondes : entre fonction publique protégée et jeunesse sans perspectives, entre mémoire coloniale et volonté d’avancer.
L’absence d’un État social efficace nourrit l’idée que la fraternité républicaine ne subsiste que dans les cercles familiaux ou communautaires. Certes, l’État distribue aides et allocations. Mais celles-ci ne compensent ni la cherté de la vie, ni le chômage endémique, ni le déficit de logements sociaux. Aux yeux de beaucoup, elles illustrent surtout les carences d’un État incapable d’assurer une véritable justice sociale.
Plus de responsabilités locales, c’est donc la possibilité de recréer des solidarités publiques, pensées et adaptées aux réalités sociales et culturelles.
Une laïcité vécue comme pluralité
La laïcité n’est pas contestée aux Antilles. Catholiques, évangéliques, croyances populaires et mémoire africaine cohabitent sans heurts majeurs. La diversité culturelle enrichit la pratique républicaine plutôt qu’elle ne la menace.
Cette laïcité vécue dans la pluralité, souple et enracinée, devrait inspirer la République tout entière. Elle démontre que le vivre-ensemble ne suppose pas l’uniformité mais l’acceptation de la diversité. Contrairement à certaines caricatures, les Antilles ne connaissent pas de tensions ethno-raciales majeures : la pluralité y est une richesse, non un obstacle.
Responsabilité locale : une nécessité républicaine
En septembre 2025, la Martinique tiendra un Congrès des élus pour débattre de son avenir institutionnel. Certains redoutent une dérive séparatiste. C’est une erreur. Revendiquer plus de responsabilités locales, ce n’est pas affaiblir la République : c’est la rendre crédible.
Une République qui ne se donne pas les moyens de faire vivre ses principes dans ses territoires ultramarins se condamne à l’hypocrisie et à la défiance. À l’inverse, une République qui fait confiance, qui partage et qui respecte, incarne enfin l’égalité, la liberté, la fraternité et la laïcité.
En vérité, ce sont les Antilles qui posent à la République une question brûlante : que valent ses principes s’ils ne sont pas rendus effectifs ? Plus de responsabilités locales ne sont pas une menace : elles sont la condition même de leur vitalité.
Gérard Dorwling-Carter