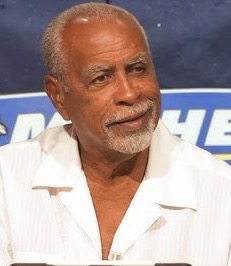Une Peur Ancestrale et des Menaces Écologiques
La peur, mécanisme de survie ancestral profondément ancré dans notre héritage, façonne aujourd’hui les réalités martiniquaises face à des défis qui redessinent le visage de l’île. Depuis 2011, l’envahissement des sargasses se présente comme une épée de Damoclès écologique, dont les émanations toxiques de sulfure d’hydrogène affectent 23 % de la population côtière et entraînent, parallèlement, une baisse de 18 % du tourisme balnéaire ainsi que des pertes halieutiques évaluées à 4,7 millions d’euros par an. Les stratégies de lutte, nécessitant des investissements annuels de l’ordre de 2 millions d’euros, demeurent fragilisées par l’absence de solutions durables.
Le Changement Climatique et ses Conséquences
Le changement climatique vient amplifier ces risques en accélérant l’érosion côtière – en hausse de 12 % depuis 2020 – menaçant ainsi 15 % des infrastructures littorales. Il se manifeste également par une alternance de sécheresses prolongées et d’inondations destructrices, comme en témoigne une période de 147 jours sans pluie en 2024, et les pluies incessantes actuelles. Ces crises environnementales se mêlent à des tensions sociales profondes.
Déclin Démographique et Tensions Sociales
La spirale du déclin démographique, avec une baisse de 9,8 % de la population en dix ans et un vieillissement marqué (un actif pour 1,8 retraité en 2025), s’accompagne d’un exode massif des 18-35 ans – 42 000 départs depuis 2015. Ce phénomène accentue le déficit de compétences locales et entraîne la désertification progressive des services publics dans de nombreuses communes.
Violence, Sécurité et Économie à Deux Vitesses
Parallèlement aux enjeux écologiques et démographiques, la violence s’est accentuée, comme le montrent la problématique de la Vie chère, les émeutes et les incendies. La présence parfois excessive des forces de l’ordre peine à instaurer un climat de sécurité apaisé. À cela s’ajoute la sur rémunération des fonctionnaires, qui contribue à alimenter l’inflation et engendre une économie à deux vitesses, creusant ainsi le fossé entre les différentes couches de la société.
Gouvernance et Héritage Historique
Les problèmes de gouvernance de la collectivité territoriale de la Martinique viennent aggraver ce tableau. Des difficultés persistantes de personnel et de finances, une organisation déficiente des transports publics et une couverture de santé insuffisante, autant de dysfonctionnements qui compromettent le vivre ensemble. Par ailleurs, l’instrumentalisation permanente de l’histoire douloureuse de la traite et de l’esclavage, loin de favoriser la réconciliation, alimente les divisions et entretient un sentiment de ressentiment, rendant le dialogue social d’autant plus complexe.
Initiatives et Obstacles
Face à cette accumulation de crises, certaines avancées ont été annoncées, telles que la surveillance satellitaire couvrant 92 % des côtes et les projets pilotes de biovalorisation initiés par le GIP Sargasses en 2023. Cependant, ces initiatives se heurtent à des obstacles majeurs, tels que des financements erratiques, des retards technologiques et une pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée. Le climat d’insécurité qui en résulte se manifeste par le fait que 68 % des jeunes renoncent à fonder une famille sur l’île et que le sentiment d’abandon étatique culmine dans les zones rurales. De nombreux habitants adoptent alors des stratégies individuelles de résilience, telles que la formation à l’expatriation ou le stockage alimentaire, au détriment de solutions collectives.
Vers une Transformation Collective
Ainsi, la peur martiniquaise, tout en mobilisant des énergies créatrices à travers l’innovation écologique et les solidarités diasporiques, révèle aussi sa face sombre. Elle se mue en une prophétie auto-réalisatrice, où l’anticipation anxieuse des catastrophes accélère leur avènement par un désinvestissement progressif du territoire. Pour surmonter ce cercle vicieux, il apparaît indispensable de transformer cette émotion primitive en un levier d’action collective pérenne, capable de repenser la gouvernance, de réconcilier le passé et de bâtir un avenir commun. L’intégration de l’histoire douloureuse de la traite et de l’esclavage doit ainsi promouvoir la cohésion plutôt que de la diviser.
Gérard Dorwling-Carter