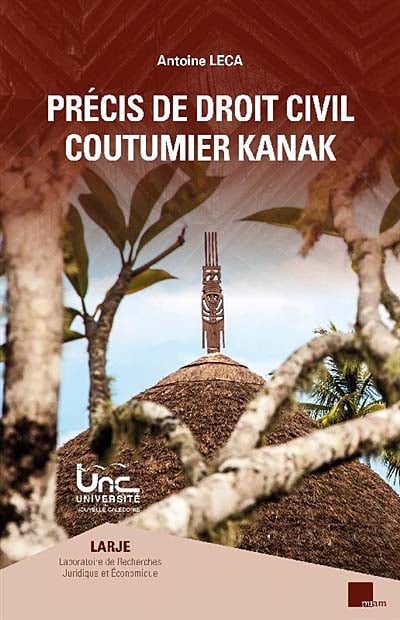Les récentes décisions de la chefferie de Gureshaba, à Maré, d’interdire la venue de certains responsables politiques loyalistes sur ses terres coutumières ont provoqué un tollé à Nouméa et à Paris. Un article paru semaine passée parle d’« apartheid politique » et de « sécession symbolique », accusant les autorités coutumières de franchir une ligne rouge. Mais ce procès en illégitimité occulte des réalités juridiques, historiques et culturelles essentielles.
Le droit coutumier, partie intégrante de la République
La Constitution française, en son article 75, reconnaît aux populations d’outre-mer régies par le droit coutumier le droit de conserver leurs coutumes. En Nouvelle-Calédonie, cela se traduit notamment par la maîtrise des terres coutumières par les autorités traditionnelles. Ces terres ne sont pas des espaces publics au sens du code général des collectivités, et leur accès peut être restreint dans certaines circonstances, notamment en période de deuil ou de tensions sociales. Présenter cette décision comme une atteinte absolue à la liberté de circulation, sans rappeler cette spécificité, revient à tronquer le cadre légal.
Un geste symbolique avant tout
La chefferie de Gureshaba a expliqué fonder sa décision sur le maintien du deuil après les violences de mai 2024. Dans la culture kanak, le deuil n’est pas un acte privé et ponctuel, mais un processus communautaire prolongé, qui implique des règles strictes de comportement et de relations extérieures. Réduire cette justification à un simple « prétexte » nie la valeur symbolique et sociale que revêt ce geste dans le cadre coutumier.
L’accord de Bougival n’est pas un dogme
Qualifier l’accord de Bougival de « socle commun » et opposer des « loyalistes loyaux » à des « séparatistes violents » est une vision binaire qui empêche tout débat démocratique apaisé. De nombreux acteurs, y compris pacifiques, contestent certaines dispositions de cet accord pour des raisons de fond : répartition des compétences, statut institutionnel, souveraineté, maîtrise foncière. Les mettre tous dans le même sac revient à délégitimer une partie importante de la population.
Prudence face à la tentation répressive
La menace de sanctions brandie par le Haut-commissaire peut apparaître comme une réponse ferme, mais elle comporte un risque bien réel : celui de transformer un différend ponctuel en affrontement durable. L’histoire calédonienne nous enseigne que l’imposition autoritaire de la « loi commune » sur des terres coutumières, surtout en période de tension, peut provoquer des blocages plus graves que le problème initial.
Un débat qui mérite nuance
L’article qui s’indigne aujourd’hui emploie un lexique polarisant – « apartheid », « sécession », « point de bascule » – qui alimente la peur plutôt qu’il n’éclaire la complexité de la situation. Aucune voix de la chefferie n’y est citée, aucun rappel des règles coutumières n’est apporté. Or, pour comprendre et résoudre ce type de conflit, il faut d’abord reconnaître que la Nouvelle-Calédonie repose sur un équilibre fragile entre le droit républicain et le droit coutumier. C’est cet équilibre qui permet d’avancer, pas la stigmatisation.
La République ne peut pas, d’un côté, affirmer reconnaître la coutume kanak, et de l’autre, la délégitimer dès qu’elle contrarie l’agenda politique du moment.
Ce qui est en jeu aujourd’hui, ce n’est pas seulement la circulation de quelques élus sur une île, mais la capacité de la Nouvelle-Calédonie à conjuguer pluralité juridique et respect mutuel. C’est sur ce terrain-là que doit se construire la suite du dialogue.