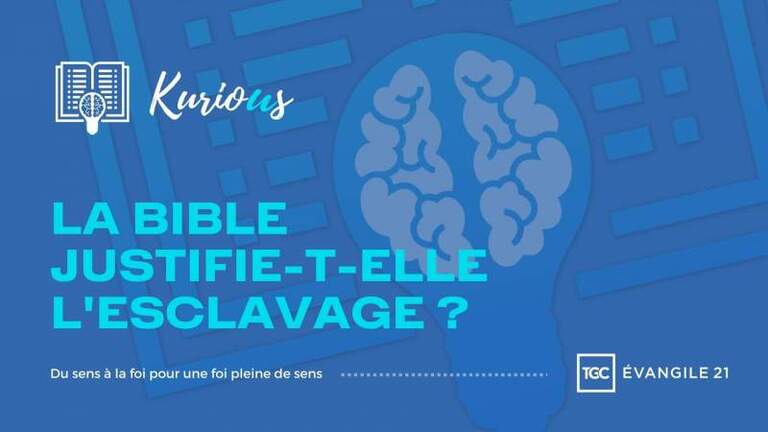Un paradoxe moral au cœur de la chrétienté
Un article d’Aaron Menikoff « Comment et pourquoi certains chrétiens ont-ils défendu l’esclavage ? » publié par The Gospel Coalition (2017) et traduit sur Les-Crises.fr revient sur un paradoxe historique : comment des chrétiens, fervents défenseurs de la Bible, ont pu justifier une institution aussi inhumaine que l’esclavage.
À travers le cas du pasteur baptiste américain Richard Fuller, l’auteur explore les arguments religieux qui ont longtemps servi à défendre l’ordre esclavagiste aux États-Unis.
La Bible instrumentalisée
Fuller soutenait que l’esclavage n’était pas un péché, car ni l’Ancien ni le Nouveau Testament ne le condamnaient explicitement.
Il s’appuyait sur :
- le Lévitique 25:44, où l’achat d’esclaves étrangers est permis ;
- les épîtres de Paul (Éphésiens, Colossiens), qui demandent aux esclaves d’obéir à leurs maîtres ;
- et le silence de Jésus sur la question, qu’il interprétait comme une forme d’acceptation implicite.
Pour Fuller, si Dieu avait permis l’esclavage aux patriarches et si Jésus ne l’avait pas condamné, alors il ne pouvait s’agir d’un péché. Il distinguait les « abus » de l’esclavage – qu’il jugeait regrettables – de l’institution elle-même, qu’il considérait légitime et naturelle.
La réplique abolitionniste de Francis Wayland
Face à lui, le théologien baptiste Francis Wayland, président de l’université Brown, publie une réfutation magistrale :
- Il affirme que l’amour du prochain (Matthieu 19:19) rend incompatible tout asservissement de l’homme par l’homme.
- Il rappelle que l’esclavage dans l’Ancien Testament relevait d’un contexte historique particulier, sans valeur normative universelle.
- Et il souligne que le message du Nouveau Testament, centré sur la liberté en Christ et l’égalité spirituelle, prépare au contraire le terrain de l’abolition.
Wayland voit dans la Bible une dynamique de libération progressive : non une justification de l’esclavage, mais son dépassement par la charité et la dignité humaine.
Une herméneutique pervertie
Menikoff démontre que la faute de Fuller n’était pas seulement morale, mais herméneutique — une mauvaise lecture de la Bible.
Les esclavagistes confondaient réglementation et approbation : le fait que la Bible encadre une pratique ne signifie pas qu’elle la légitime.
Surtout, Fuller ignorait le principe central de l’Écriture : « aimer son prochain comme soi-même », qui éclaire tout le reste du message évangélique.
Le péché plus profond : le racisme
Derrière la justification religieuse, Menikoff dévoile le vrai moteur : le racisme.
Fuller et d’autres théologiens du Sud considéraient les Noirs comme inférieurs par nature – une croyance qui rendait, à leurs yeux, leur esclavage “normal” et même “bienveillant”.
Leur théologie de la hiérarchie raciale servait de fondement à une économie esclavagiste, travestie en doctrine biblique.
Le contre-modèle afro-américain
À l’opposé, des pasteurs noirs comme Lemuel Haynes affirmaient que tous les êtres humains, noirs ou blancs, sont créés à l’image de Dieu (imago dei).
Ils voyaient dans le message chrétien une promesse universelle d’égalité et de réconciliation.
Haynes proclamait : « Ce n’est que lorsque les Noirs et les Blancs seront considérés comme de véritables égaux que nous pourrons goûter au paradis sur terre. »
Leçon pour aujourd’hui
Menikoff conclut : l’Église n’a pas surmonté l’esclavage en s’éloignant de la Bible, mais en la relisant fidèlement.
C’est en redécouvrant sa théologie de l’unité et de la dignité humaine qu’elle a pu rompre avec les justifications religieuses du racisme.
En Christ, il n’y a “ni esclave ni homme libre” (Galates 3:28) : cette vérité, longtemps occultée, demeure le cœur de l’Évangile.
Source : Aaron Menikoff, « How and Why Some Christians Defended Slavery », The Gospel Coalition, 24 février 2017.
Traduction : Les-Crises.fr.