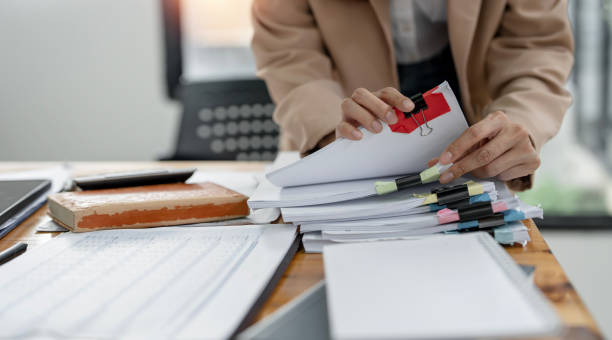Un débat récurrent, jamais tranché
Le débat sur l’antillanisation des cadres, qui refait surface à intervalles réguliers, ressemble à un véritable « serpent de mer ». Il surgit à chaque visite ministérielle, comme récemment avec Bruno Retailleau, quand l’opinion publique constate que les hauts responsables présents sont massivement métropolitains. Ce sentiment de dépossession nourrit une indignation récurrente, mais dont l’issue reste toujours renvoyée aux calendes grecques.
La règle républicaine : mobilité et concours nationaux
La haute fonction publique française repose sur un principe de rotation et de mobilité. Les préfets, recteurs, procureurs ou directeurs d’administrations sont nommés sur l’ensemble du territoire, sans ancrage local. Exiger une exception pour les Outre-mer reviendrait à instaurer un régime particulier contraire à l’égalité républicaine, principe auquel une majorité d’Antillais reste paradoxalement attachée. C’est une première contradiction : demander un traitement distinct tout en refusant l’indépendance.
Une revendication liée à l’histoire coloniale
La singularité des Antilles françaises, marquées par la colonisation, l’esclavage et la départementalisation, nourrit le désir de reconnaissance. Voir les leviers de commandement concentrés dans des mains extérieures alimente la frustration. L’antillanisation des cadres est donc perçue comme une exigence de représentativité, un moyen d’affirmer l’identité locale dans la gouvernance.
Vieille lune ou quadrature du cercle ?
Le débat oscille entre deux visions. D’un côté, une vieille lune : depuis les années 1970, cette revendication n’a guère changé malgré quelques avancées dans l’éducation, la santé ou les collectivités locales. De l’autre, une quadrature du cercle : dans le cadre de la départementalisation, la mobilité nationale reste la règle, et même un régime d’autonomie ne résoudrait pas la question dans les secteurs régaliens. La seule véritable rupture serait l’indépendance, largement rejetée par les électorats antillais.
Des marges de manœuvre limitées mais réelles
Même si une solution miracle n’existe pas, certaines pistes peuvent être explorées. Préparer et accompagner davantage les candidats antillais aux concours, valoriser les expériences locales dans les carrières administratives, créer des passerelles avec les entreprises publiques et privées. Mais ces efforts supposent aussi une volonté de retour au pays et une amélioration du management local. L’antillanisation doit dépasser le slogan pour devenir un projet concret de justice et de représentativité.
Un problème qui dépasse les Antilles
La Nouvelle-Calédonie illustre que la difficulté ne se limite pas au cadre statutaire. Malgré une autonomie plus large, ce territoire reste confronté au même problème : absence de cadres locaux en nombre suffisant, élites indigènes freinées dans l’accès aux plus hautes responsabilités, sentiment d’un pouvoir confisqué par l’extérieur. La question de l’antillanisation – ou de la « local-isation » des cadres – révèle ainsi des blocages structurels, culturels et économiques communs à de nombreux territoires ultramarins.
Conclusion : une équation sans solution simple
L’expression de la « quadrature du cercle » reste la plus appropriée. Tant que les règles républicaines de mobilité nationale s’appliqueront et que les réalités structurelles des Outre-mer ne seront pas transformées, la question de l’antillanisation demeurera sans réponse définitive. Elle continuera de hanter le débat public, entre revendication légitime et impossibilité pratique.
“Fo pa nou antwé an lagiè san baton.”
(Littéralement : Il ne faut pas entrer en guerre sans bâton.)
Jean Marie Nol, économiste et chroniqueur