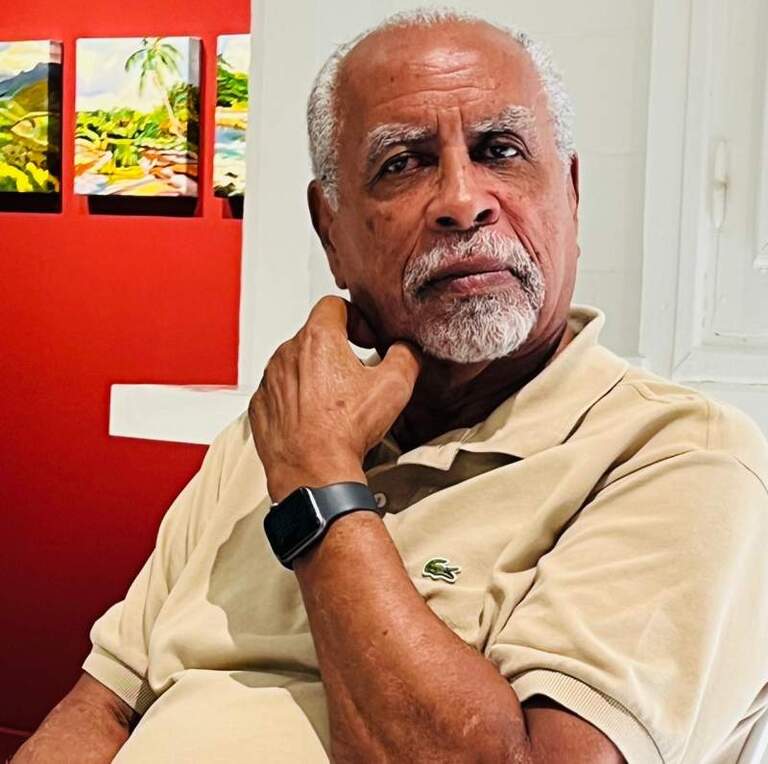Une histoire toujours vivante
En Martinique, l’histoire coloniale n’est pas un souvenir. Elle habite les mémoires, façonne les institutions, creuse les inégalités. Ici, la souveraineté ne peut être pensée dans les termes binaires du passé — entre assimilation et indépendance. Elle exige des mots neufs, des voies plurielles, une vision décentrée. Dans ces sociétés postcoloniales, la quête d’émancipation ne se résume pas à la revendication d’un État-nation. Elle s’exprime dans une autre langue : celle de la souveraineté culturelle, symbolique, écologique, éducative. Et tout autant psychologique.
Ce territoire porte le poids d’une histoire brutale — traite négrière, esclavage, colonisation — mais aussi la richesse de cultures forgées dans la résistance, la mémoire, la créolisation. Longtemps, la République a imposé l’intégration sans reconnaissance. Aujourd’hui, cette époque touche à sa fin. Les sociétés antillaises et guyanaise n’exigent pas un retrait, mais un rééquilibrage. Pas une excision, mais un respect.
Le détour et le retour : identité et relation
C’est dans ce contexte que le concept forgé par Édouard Glissant prend toute sa force. Le « détour et le retour », c’est détourner les logiques imposées — linguistiques, politiques, économiques — pour revenir à soi autrement. Non pas en se coupant du monde, mais en affirmant une identité relationnelle, ouverte, non soumise. Le détour, c’est la mise à distance de la dépendance. Le retour, c’est l’invention de soi dans la Relation, dans le dialogue avec l’autre.
Ce projet, profondément culturel et politique, ne nécessite pas nécessairement l’indépendance étatique. Il peut s’incarner dans la revalorisation des langues locales, dans l’écriture de l’histoire depuis les marges, dans la participation à des réseaux régionaux autonomes comme la CARICOM, dans des politiques culturelles souveraines. Mais il ne peut prospérer — reconnaissons-le — sans espaces de manœuvre réels, sans pouvoir d’agir, sans autonomie concrète.
Une autonomie politique — même partielle, différenciée, pragmatique — n’est pas une fin en soi, mais un levier indispensable. Elle permet de fixer des priorités propres, de traduire les besoins d’un territoire dans des politiques publiques adaptées, de parler au monde avec une voix singulière. D’autres l’ont fait : le Groenland, Porto Rico, la Nouvelle-Calédonie.
L’émancipation ne se décrète pas
Cela dit, le cœur de l’émancipation est ailleurs : dans la capacité à se penser et à se dire à la première personne. Dans le refus de l’effacement, comme dans le refus de l’enfermement. Dans la rupture avec l’universel imposé, au profit d’un universel relationnel, écrit depuis les Caraïbes, depuis l’expérience postcoloniale, depuis nos langues, nos blessures, nos renaissances.
On peut ne pas être indépendant. Mais il est dangereux d’être dépendant dans sa manière de penser, de nommer, de produire, de transmettre. L’essentiel n’est pas d’avoir un État. L’essentiel est de sortir de l’état de dépendance.
Une dépendance budgétaire structurelle
Un aspect de cette dépendance réside dans l’incapacité chronique de la Martinique à sortir du mal-développement qui l’accable. Certes, la Martinique bénéficie d’un soutien budgétaire non négligeable de l’État français. Mais elle reste confrontée à un déséquilibre structurel profond entre les dépenses publiques et ses capacités de développement.
Avec 105 fonctionnaires pour 1 000 habitants (contre 73 en moyenne dans l’Hexagone), elle dispose du plus fort taux d’agents publics en France. En 2023, les dépenses budgétaires s’élèvent à 6,8 milliards d’euros : 2,8 milliards pour les services de l’État, 3 milliards pour la Sécurité sociale, et 1 milliard de dotations aux collectivités locales. Les dépenses fiscales, c’est-à-dire les recettes non perçues (exonérations, réductions), atteignent 700 millions d’euros, auxquelles s’ajoutent 500 millions pour la péréquation tarifaire de l’électricité.
Au total, cela représente un engagement public d’environ 21 400 euros par habitant, presque équivalent au PIB local. Pourtant, les recettes réellement perçues (cotisations sociales et impôts) ne dépassent pas 2,4 milliards d’euros. Le déficit structurel est de 4,4 milliards. À cela s’ajoutent 286 millions d’euros d’aides européennes (FEDER, FSE+, POSEI) et 260 millions du plan France Relance.
Une gouvernance locale inefficace
La situation budgétaire locale, pour toutes sortes de raisons, ne compense en rien ce déséquilibre. La CTM, avec un budget de 1,5 milliard d’euros, consacre près de deux tiers de ses dépenses au fonctionnement (999 millions), dont 262 millions pour les salaires. Malgré une capacité d’autofinancement importante, les investissements diminuent, l’endettement progresse, et la capacité de désendettement se dégrade. La Cour régionale des comptes l’a souligné dès 2020. La situation est aggravée par un sureffectif administratif : en 2024, quelque 200 agents « fantômes » ont été identifiés.
La fiscalité locale, elle aussi, est mal calibrée.
L’octroi de mer — taxe sur les importations — représente 949 euros par habitant, contre 635 euros à La Réunion, mais seuls 5,6 % sont affectés au développement économique, contre 22,8 % en Guyane. Les communes martiniquaises imposent leurs habitants à hauteur de 1 275 euros (contre 667 euros en moyenne dans les communes françaises de taille équivalente) et affichent une dépense de fonctionnement record outre-mer : 1 645 euros par habitant, dont 67 % pour le personnel. Pendant ce temps, les investissements chutent : l’équipement ne représente plus que 13 % du budget communal, contre 25 % en France hexagonale.
Une pauvreté bien financée
Ce paradoxe est alarmant : la Martinique reçoit d’importants transferts publics, mais reste enfermée dans une logique de dépendance budgétaire, de sous-investissement productif et de stagnation économique. Ni les subventions nationales ni les aides européennes ne pourront compenser une gouvernance défaillante, un modèle économique figé, une architecture institutionnelle inadaptée aux défis du XXIe siècle.
Le quotidien des carences
La réalité saute aux yeux : un système de santé à bout de souffle, des hôpitaux en déficit chronique, des urgences saturées, des équipements vétustes. Une école publique en crise, avec des bâtiments dégradés et une démotivation croissante des enseignants. Des transports collectifs peu fiables, voire absents. Une jeunesse frappée par le chômage et le décrochage scolaire.
Ce n’est pas une fatalité. C’est un choix politique. Ou plutôt, l’absence de choix.
Car derrière les discours sur l’égalité républicaine, les chiffres révèlent l’écart. Les dotations ne compensent ni les surcoûts liés à l’insularité, ni les besoins spécifiques liés au vieillissement, à la précarité ou à la dépendance commerciale. Les investissements promis arrivent tard, mal calibrés, ou ne viennent pas.
Dignité, stratégie, transformation
Dans ce contexte, revendiquer un budget adapté, ce n’est pas quémander un privilège : c’est revendiquer le droit de vivre dans la dignité. Il ne s’agit pas d’aligner mécaniquement la Martinique sur les standards hexagonaux, mais de reconnaître qu’un territoire marqué par l’esclavage, la colonisation, une départementalisation incomplète et les défis climatiques majeurs a besoin de moyens spécifiques, durables, orientés vers la résilience et la justice sociale.
Ce qu’il faut, ce ne sont pas des rustines. C’est une stratégie. Une vision. Une architecture budgétaire fondée sur sept piliers essentiels :
- refonder le système de santé ;
- moderniser l’école et revaloriser les enseignants ;
- réorganiser les transports pour désenclaver les territoires ;
- investir dans la transition écologique et réparer les ravages du chlordécone ;
- soutenir les économies locales et les filières d’avenir ;
- garantir une justice sociale réelle ;
- redonner aux collectivités des moyens et une vraie autonomie d’action.
Ces objectifs ne relèvent pas du luxe. Ils relèvent du minimum vital pour une société qui veut rester debout. Laisser perdurer le sous-financement, c’est choisir le découragement, l’exil, la colère.
Une loi de programmation pour respirer
Il est temps d’adopter une loi de programmation budgétaire spécifique aux Outre-mer, co-construite avec les territoires. Il faut un plan d’investissement pluriannuel, inscrit dans le droit commun, mais calibré sur les besoins réels. Il faut mettre fin à cette logique de dépendance masquée, qui distribue des aides ponctuelles sans restaurer la capacité des territoires à décider, à planifier, à agir.
Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement le budget d’une île. C’est le pacte républicain lui-même, confronté à son miroir ultramarin.
Il n’y aura pas d’égalité réelle sans justice budgétaire. Pas de dignité sans moyens. Pas de paix durable sans reconnaissance des dettes historiques, économiques, sociales envers les peuples d’Outre-mer. Et surtout, il n’y aura pas d’avenir si la Martinique ne peut même plus rêver — faute de budget pour simplement respirer.
Il ne s’agit pas de tourner la page.
Il s’agit, enfin, d’écrire notre histoire à la première personne.
Gérard Dorwling-Carter