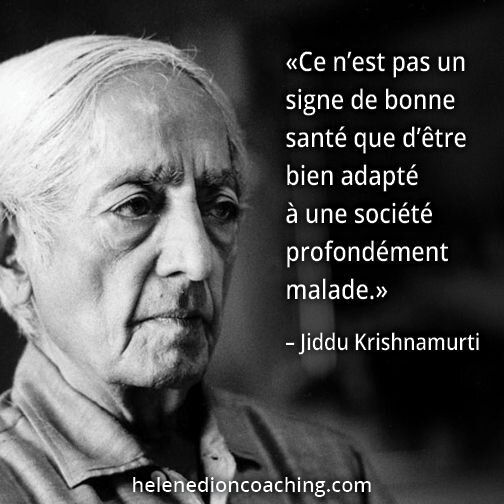« La plupart des gens! s’oublient eux-mêmes. »
Huston Smith (1919-2016) fut l’un des plus éminents spécialistes américains des religions et de la philosophie comparée au XXᵉ siècle. Sa brillante carrière, marquée notamment par son poste de professeur de philosophie au MIT de 1958 à 1973, fut également ponctuée d’émissions de télévision locales où il anima des programmes explorant les questions de spiritualité, de sens et de croyance. Parmi ceux-ci figurait The Search for America (1959-1960), dans lequel il interviewait des penseurs de renom afin de trouver des réponses morales à seize des questions publiques et privées les plus fondamentales auxquelles les Américains sont confrontés.
Dans cet extrait d’un épisode consacré à la santé mentale, Smith s’entretient longuement avec le psychologue social, psychanalyste et philosophe Erich Fromm (1900-1980), un Juif allemand ayant fui le nazisme pour s’installer aux États-Unis en 1934.
Abordant ce qu’il considère comme les maux de la société américaine — aliénation, conformisme, consumérisme et menace d’annihilation nucléaire —
Fromm pose une question décisive : si une personne peut être mentalement malade, une société entière peut-elle l’être aussi ?
Fromm rappelle que le rôle initial des institutions psychiatriques devrait être de favoriser l’épanouissement humain et de soulager la souffrance psychique. Or, selon lui, une partie du champ psychiatrique de son époque se contente avant tout d’adapter les individus à un système qu’elle juge pourtant intrinsèquement « insensé », en privilégiant la normalisation plutôt que la compréhension ou la transformation des causes profondes du malaise.
Il souligne que, dans une société où prime l’efficacité économique et la recherche de statut, l’individu risque d’être réduit à une fonction. Dans cette logique, la santé mentale n’est plus définie par la capacité à mener une vie pleine, dotée de sens et d’autonomie intérieure, mais par la capacité à rester productif, acheter, consommer et se conformer — ce que Fromm appelle une forme de folie socialement acceptable.
Certains aspects de la discussion reflètent l’angoisse du temps : la peur de la guerre nucléaire, l’obsession de l’abondance matérielle, les malaises du capitalisme triomphant. Mais d’autres dimensions semblent presque prophétiques. Fromm insiste en effet sur le fait qu’une société de consommation offre une infinité d’échappatoires à la réalité — divertissements, objets, distractions — mais laisse souvent les individus structurellement insatisfaits, incapables de répondre à leurs besoins de relation, de créativité et d’ancrage intérieur.
Pour lui, la véritable santé mentale passe par un changement de paradigme : retrouver un rapport vivant au monde, fondé sur la responsabilité, la conscience de soi, la solidarité et l’amour, contre les mécanismes anonymes d’une société qui pousse à « avoir » plutôt qu’à « être ».
Ainsi, la question de Smith — une société peut-elle être malade ? — reçoit de Fromm une réponse nuancée mais ferme : oui, lorsqu’un système entier normalise l’aliénation au point de considérer comme « sain » ce qui rend les individus profondément malheureux.
Jean-Paul BLOIS