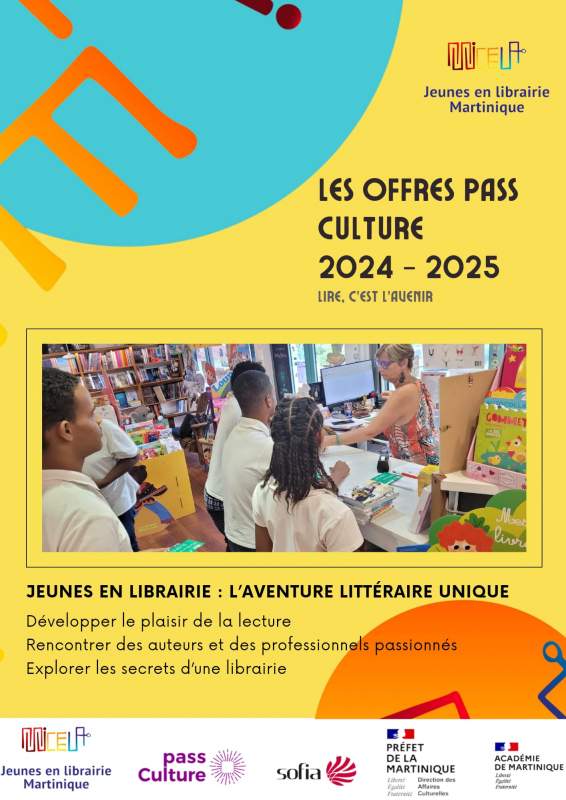Alors que la SAS Pass Culture expérimente pour la première fois le partage de ses données avec des collectivités françaises, la Martinique reste à la porte de cette initiative. Pourtant, les usages culturels des jeunes Martiniquais mériteraient une attention particulière : les chiffres, les pratiques et les attentes diffèrent sensiblement de celles de l’Hexagone.
Un dispositif sous surveillance
Créé pour rapprocher les jeunes de la culture, le Pass Culture permet à chaque bénéficiaire de 18 ans de disposer d’un crédit de 300 € à dépenser en livres, concerts, cinéma, jeux ou spectacles.
Depuis sa généralisation en 2021, plus de 9 500 jeunes martiniquais ont utilisé le dispositif, majoritairement pour le cinéma, la musique ou les mangas, selon les données du ministère de la Culture.
Mais un paradoxe persiste : si le pass a bien créé une dynamique d’accès, il reste mal arrimé aux acteurs culturels locaux, faute de coordination et de transparence sur les usages.
« Le dispositif favorise les grandes plateformes nationales. Les librairies ou structures locales restent invisibles », confie Caroline Malleville, libraire indépendante à Fort-de-France.
« Nous aimerions savoir comment les jeunes utilisent vraiment leur pass, ici, chez nous. »
Un partage de données attendu
En septembre 2025, la SAS gestionnaire du Pass Culture a annoncé une expérimentation de partage de données avec 16 collectivités hexagonales – de Strasbourg à Angoulême, en passant par Lyon et Vannes.
Objectif : permettre aux élus de mieux connaître les pratiques culturelles des 15-20 ans et d’adapter leurs politiques publiques.
Aucune collectivité ultramarine n’a été intégrée à cette première phase.
Un manque qui interroge, alors que la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) investit déjà dans la médiation culturelle et les équipements de lecture publique.
« Si nous avions accès à ces données, nous pourrions cibler nos actions – notamment dans les lycées du Nord et les zones rurales », estime un responsable de la culture.
Des critiques récurrentes
La Cour des Comptes avait déjà pointé, dans un rapport de 2024, le manque de transparence de la société Pass Culture.
Ses bases de données, jugées « inédites et précieuses », n’étaient que très partiellement partagées avec le ministère de la Culture, pourtant principal financeur.
L’institution recommandait la mise en place d’une plateforme publique permettant aux collectivités d’accéder gratuitement à des données anonymisées sur les usages culturels des jeunes.
Cette ouverture, réclamée depuis plusieurs années, permettrait de bâtir une observation culturelle partagée – indispensable pour les Outre-mer, où les réalités sociales et territoriales diffèrent profondément de celles de l’hexagone.
La Martinique veut sa place
Avec 28 % de jeunes de moins de 25 ans, la Martinique dispose d’un potentiel culturel considérable. Mais pour le valoriser, encore faut-il disposer d’indicateurs précis : taux d’utilisation par commune, typologie des achats, part du numérique ou des lieux physiques.
L’inclusion du territoire dans la seconde phase de l’expérimentation, annoncée pour 2026, est donc devenue un enjeu stratégique.
Il faut une approche concertée : associer les médiathèques, les lycées, les associations culturelles et les acteurs économiques locaux afin de mieux comprendre les comportements culturels de la jeunesse martiniquaise.
Repères
- 9 500 jeunes martiniquais ont utilisé le pass en 2024
- 300 € de crédit individuel pour chaque bénéficiaire
- 58 % des dépenses : cinéma, musique, streaming, mangas
- Moins de 15 % : livres ou activités culturelles locales
- 0 collectivité ultramarine intégrée à l’expérimentation actuelle
Et maintenant ?
Un point d’étape aura lieu lors du Salon des maires et des collectivités locales en novembre 2025.
La Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) y présentera les premiers résultats du partage de données.
La CTM devrait y participer n tant qu’observatrice – avec l’ambition de faire reconnaître la Martinique comme territoire pilote ultramarin pour la culture connectée.
Jean-Paul Blois