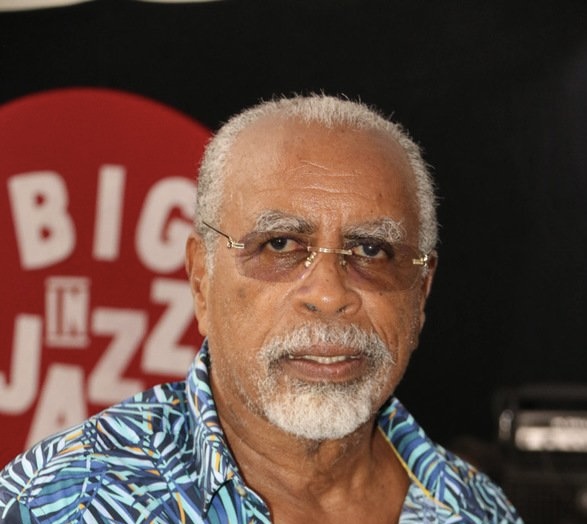Les présidents des treize régions métropolitaines parlent d’une seule voix : pour agir efficacement, il faut désormais pouvoir adapter la loi à la réalité du terrain.Depuis plusieurs mois, une voix unique s’élève des treize grandes régions de l’Hexagone : celle d’un appel à plus de responsabilités, plus d’autonomie et surtout plus de cohérence dans l’action publique.
À droite comme à gauche, les présidents de région réclament aujourd’hui non pas une révolution institutionnelle, mais un ajustement lucide : celui d’un pouvoir normatif réel, leur permettant d’adapter la règle nationale aux réalités locales.
L’épuisement du modèle jacobin
La France demeure l’un des pays les plus centralisés d’Europe. Malgré quarante ans de décentralisation, l’État conserve le monopole de la norme et la mainmise sur la décision. Les régions, agrandies en 2015 au nom de la rationalisation, sont restées des géantes administratives aux pieds d’argile. Elles assument des responsabilités croissantes sans disposer des leviers juridiques ni fiscaux nécessaires pour agir avec efficacité. Or, dans un monde où les crises se multiplient, la lenteur et la rigidité du modèle jacobin ne sont plus soutenables.
Le pouvoir d’adapter, non de rompre
Ce que les régions réclament, ce n’est pas une indépendance institutionnelle, mais une capacité d’action. Elles demandent le droit d’adapter les politiques publiques aux besoins de leur territoire : logement, santé, éducation, formation, transition écologique. Elles souhaitent une responsabilité partagée, où la République fixe les principes et où les collectivités décident des modalités. Le pouvoir normatif n’est pas une menace pour l’unité ; il en serait, au contraire, la garantie moderne.
La confiance citoyenne se déplace
Les enquêtes d’opinion le confirment : les Français font désormais davantage confiance à leur région qu’à l’État pour faire avancer les politiques publiques. Ce basculement silencieux traduit un mouvement profond : la recherche d’efficacité et de proximité. Les citoyens veulent que la décision se prenne là où les problèmes sont vécus. Face à cette réalité démocratique, refuser le partage du pouvoir normatif reviendrait à nier le bon sens des territoires.
La République, c’est aussi la différenciation
L’unité nationale ne repose plus sur l’uniformité, mais sur la capacité d’adaptation. Chaque région possède ses atouts, ses contraintes, ses urgences : un modèle agricole, industriel, social, culturel. La transition énergétique, la relocalisation des filières, la planification écologique ne peuvent se décréter depuis Paris. Elles exigent des règles souples, des cadres expérimentaux, une confiance assumée envers les acteurs locaux. Le pouvoir normatif régional, loin d’être un privilège, serait la clé d’une République réinventée.
Un tournant à ne pas manquer
La France s’approche d’un moment charnière : soit elle continue à gérer les territoires depuis le centre, au risque de la paralysie ; soit elle admet que l’intelligence collective vient du terrain. Donner aux régions le pouvoir d’agir, c’est refuser la défiance institutionnelle. C’est croire que la démocratie peut être horizontale, collaborative, adaptée aux enjeux contemporains. À l’heure où la société française doute, où l’État peine à répondre à la complexité du réel, le pouvoir normatif régional n’est pas une concession : c’est une preuve de maturité. Et peut-être, la seule manière de sauver la République d’elle-même.