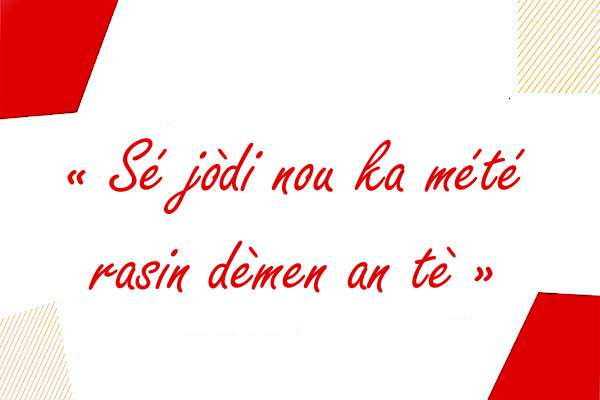Vers une responsabilité partagée entre l’État et la Martinique
En 2025, le mot autonomie change de visage. Loin des craintes d’hier, il devient le symbole d’une responsabilité partagée entre l’État et le territoire. La Martinique, à travers la domiciliation du pouvoir normatif local, choisit une voie nouvelle : celle d’une autonomie d’adaptation, lucide, constructive. Mais cette évolution se déroule aussi dans un contexte national où Sébastien Lecornu, redevenu Premier ministre, propose un aménagement de la décentralisation applicable à l’ensemble des territoires. Deux projets se dessinent alors : une gouvernance différenciée portée localement, et une décentralisation rénovée impulsée par Paris — deux voies potentiellement complémentaires si elles s’accordent sur le principe de la confiance.
Une responsabilité partagée dans la République
Être autonomiste, aujourd’hui, ce n’est pas se séparer, mais mieux se gouverner. C’est vouloir adapter les politiques publiques à la réalité insulaire, dans le cadre de la République. La domiciliation du pouvoir normatif local, adoptée à l’unanimité par les élus martiniquais le 8 octobre 2025, traduit cette ambition : permettre à la Martinique de définir ses propres règles dans les domaines où elle a compétence. Ce projet s’inscrit dans une logique d’autonomie d’adaptation, entre les articles 73 et 74 de la Constitution, et s’accorde avec la volonté exprimée par le gouvernement Lecornu d’aménager la décentralisation sans bouleverser l’unité de la République.
Deux projets, un même horizon : la responsabilité
Le projet porté par le Congrès des élus martiniquais et celui du gouvernement ne s’opposent pas nécessairement. Le premier, né d’une volonté locale, vise à renforcer le pouvoir normatif du territoire, pour ajuster les politiques publiques aux réalités insulaires. Le second, impulsé par l’exécutif national, cherche à moderniser la décentralisation, en confiant davantage de moyens et de souplesse aux collectivités. Ces deux dynamiques peuvent converger si elles s’appuient sur une même conviction : la co-responsabilité entre l’État et les territoires.
Un levier de développement, pas une idéologie
L’autonomie n’est pas un mot de rupture ni un instrument de nostalgie. Elle est un levier de développement, une chance pour repenser l’économie, l’éducation, la culture et la gouvernance. C’est d’abord une autonomie économique et culturelle, permettant d’agir sur les leviers locaux : relancer la production, réguler le coût de la vie, soutenir les jeunes entrepreneurs, encourager l’innovation. Elle vise à faire de la Martinique un espace de décisions adaptées, et non un simple prolongement administratif du centre.
Une prise de responsabilité lucide et partagée
L’autonomie exige rigueur et maturité. Sa réussite dépendra de la mobilisation des élus, des entreprises, des syndicats et de la société civile. Mais plus profondément, elle repose sur un pari : celui de la confiance d’un peuple en lui-même. Croire en l’autonomie, c’est reconnaître ses forces comme ses faiblesses, refuser la résignation et choisir la responsabilité. Ce n’est pas une fuite en avant, mais une prise de responsabilité lucide, fondée sur la conviction que l’intérêt commun prime sur les intérêts catégoriels.
Refonder le contrat républicain sur la confiance
En redéfinissant la relation entre la Martinique et l’État, l’autonomie propose un nouveau pacte : de la dépendance à la co-responsabilité, de la tutelle à la confiance. Elle ne rompt pas le lien avec la République — elle le refonde. Dans cette perspective, la proposition de Sébastien Lecornu d’un acte III de la décentralisation à géométrie variable pourrait offrir un cadre souple où la Martinique invente sa propre voie, tout en restant pleinement française.
Ce choix d’avenir affirme une conviction simple : un peuple peut être pleinement lui-même, conscient de ses fragilités, et pourtant profondément attaché à la République. C’est en cela que l’autonomie devient un gage de confiance collective, et peut-être, le fondement d’une nouvelle étape du destin martiniquais.
Gérard Dorwling-Carter.