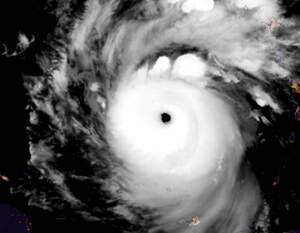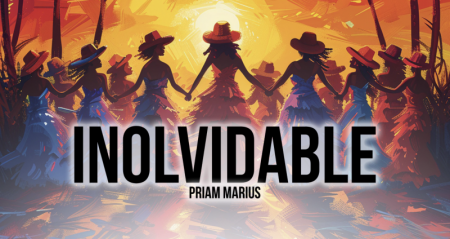La naissance d’une autre perspective mémorielle
1998, année du 150e anniversaire de l’abolition de l’esclavage, marque une rupture décisive dans le régime mémoriel français de la traite et de l’esclavage colonial. Cette célébration ouvre une opportunité inédite pour rendre visible dans l’espace public, médiatique et politique une nouvelle mémoire de l’esclavage. En janvier 1998, le « Comité pour une commémoration unitaire du cent cinquantenaire de l’abolition des nègres dans les colonies françaises », collectif qui « fédère » 300 associations, acte l’organisation d’une « marche silencieuse à Paris le 23 mai 1998 ». Le mouvement reconnaît entièrement la légitimité de commémorer le décret d’abolition et la figure héroïque de Schœlcher, mais une autre mémoire centrée sur les victimes de l’esclavage est revendiquée. L’affirmation, longtemps taboue et honteuse, de « descendants d’esclaves » est clairement assumée.
Le choix de la date retenue pour cette action fondatrice est significatif. En effet, le 23 mai n’est pas la date où l’esclavage a été officiellement aboli en France et elle ne correspond pas à la chronologie institutionnelle de la métropole. Cette date est celle où l’abolition de 1848 est pour la première fois entrée en application dans un outremer français, en l’occurrence en Martinique. Elle a donc été choisie pour organiser la marche de 1998 afin que les «descendants d’esclaves » puissent donner un écho à leur histoire.
Cette marche silencieuse, qui rassemble à Paris entre 20 000 et 40 000 personnes, exige la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité et l’érection d’un mémorial place des Antilles. Sur des banderoles, on peut lire des slogans comme « tous nés en 1848 = révisionnisme » ou encore « nous sommes des filles et fils d’esclaves ».
La création du Comité Marche 98 (CM98)
Encouragés par la dynamique de cette mobilisation, les coordinateurs du comité d’organisation décident de fonder en juin 1999 une structure pérenne, « Le Comité marche 98 (CM98) ».
Cette association est d’abord présidée par le généticien et militant de la reconnaissance de l’histoire de l’esclavage d’origine guadeloupéenne Serge Romana. Une première étape dans la réalisation de ses objectifs est atteinte avec la loi Taubira du 10 mai 2001 qui reconnait l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. Une seconde étape est franchie avec l’adoption de la loi égalité réelle outre-mer du 14 février 2017 qui institue la date du 23 mai comme la journée en mémoire aux victimes de l’esclavage. L’association continue d’impulser des commémorations annuelles baptisées « fêtes de la Fraternité et de la Réconciliation » ou « Limié Ba Yo » (« Mettons-les en lumière ») tous les 23 mai. Elle porte aussi le projet d’un grand mémorial national, comprenant la liste des 200 000 esclaves affranchis par l’abolition française de 1848, qui prendrait place au jardin des Tuileries à Paris.
Source site de Cm98
Simon Férelloc