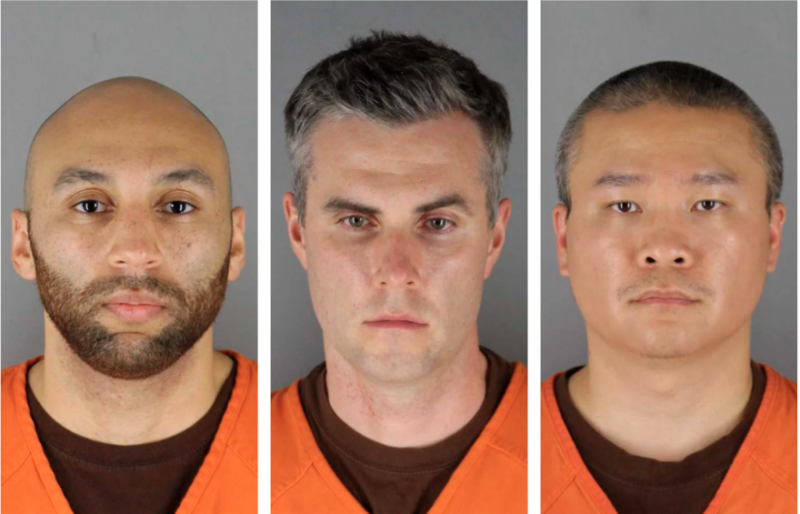S’appuyant sur le travail de la commission d’historiens, les parties civiles réclament la reprise de l’enquête sur le massacre de Bisesero.
Le rapport de la commission Duclert sur la responsabilité de la France au Rwanda (1990-1994) a fait avancer le travail historiographique. Publié fin mars, suivi de la déclassification de près de 8 000 documents, il a aussi fourni une matière de référence aux spécialistes du droit, à l’origine de procédures lancées depuis deux décennies. Soit un enchevêtrement, en France, de dizaines d’enquêtes. Jeudi 22 avril, les avocats de six parties civiles ont ainsi adressé un courrier aux juges du pôle crimes contre l’humanité – crimes de guerre, cosaisis d’une instruction ouverte en 2005, afin de les inviter à reprendre leurs investigations et à procéder à de nouveaux actes. Au cœur de cette instruction : le massacre de centaines de Tutsi par les Hutu sur les collines de Bisesero, près du lac Kivu, fin juin 1994, pendant l’opération « Turquoise » organisée par la France. Ces plaintes de rescapés, portées notamment par l’association Survie, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et la Ligue des droits de l’homme (LDH), visent une période de trois jours, entre les 27 et 30 juin. Une période au cours de laquelle les militaires français ne sont pas intervenus pour empêcher les massacres. Négligence ? Erreur d’analyse de la situation ? La réponse se trouve dans les informations dont disposaient les soldats, leurs courroies de transmission, la nature des décisions prises ensuite à Paris et leur exécution. Pourtant, les magistrats qui se sont succédé ont semblé circonscrire l’enquête aux seuls soldats déployés sur le terrain, réfutant l’hypothèse d’une complicité de génocide. Une accusation rejetée aussi par la commission d’historiens présidée par Vincent Duclert. Aucune mise en examen n’a été décidée dans l’instruction, seuls des témoins assistés ont été entendus. En juin 2019, les juges avaient refusé de poursuivre leurs investigations, mais le parquet, prudent, n’a toujours pas pris de réquisitions. « C’est peut-être lié au fait qu’on était dans l’attente du rapport Duclert, avance Me Patrick Baudouin, avocat de la FIDH. Au vu de ce document, il paraît impossible de limiter l’enquête au petit microcosme de militaires présents sur place. » La possible rencontre entre le président français, Emmanuel Macron, et son homologue rwandais, Paul Kagame, en mai, pourrait accentuer l’intérêt pour ces procédures judiciaires françaises. La lettre aux juges met en cause leur refus « de chercher la manifestation de la vérité dans l’entourage du chef des armées de l’époque, le président de la République ». Le courrier estime que « les conseillers, politiques ou militaires » de François Mitterrand et les haut gradés du ministère de la défense devraient être entendus, voire poursuivis. Huit personnalités sont citées, parmi lesquelles figurent Hubert Védrine, alors secrétaire général de l’Elysée, François Léotard, ministre de la défense, Bruno Delaye, conseiller Afrique du président, ou encore le général Christian Quesnot, chef de l’état-major particulier du président. « Le secret-défense a été fréquemment opposé à nos demandes, explique Me Eric Plouvier, avocat de Survie. A Bisesero ont lieu des massacres non loin des troupes françaises dont les chefs étaient en lien, notamment pour le recueil d’informations, avec des proches de tueurs. Ces chefs sont dans une chaîne de commandement qui remonte jusqu’aux combles du palais de l’Elysée où l’on est obsédé par le Front patriotique rwandais (FPR), et non par le souci de sauver des vies. Cette chaîne s’est enrayée à cause de cette duplicité dans la finalité de “Turquoise”. » Cette opération militaire avait été déclenchée le 22 juin 1994 sous l’égide du Conseil de sécurité, alors que le Rwanda était plongé dans l’horreur du génocide des Tutsi depuis le 6 avril. La commission Duclert s’est penchée sur les notes qui ont circulé entre les militaires français sur le terrain et leur hiérarchie à Paris. Il est difficile d’en tirer des conclusions définitives, en raison de la part informelle dans la prise de décision, de la destruction volontaire de certaines archives, notamment à l’état-major particulier, à l’Elysée. Mais ce qui apparaît au minimum – sans relever forcément du champ pénal – est un lourd retard et égarement dans l’évaluation de la situation. « Bisesero est à la fois un échec et un drame. Quand bien même la prise de conscience collective du commandement français se fait progressivement, Bisesero constitue un tournant dans la prise de conscience du génocide, note le rapport Duclert. Il y a un avant et un après Bisesero. » La commission souligne que, dès le 1er juin, la direction du renseignement militaire (DRM) mentionnait Bisesero comme pouvant abriter 1 000 Tutsi. Mais des problèmes de sources et de circulation de l’information vont handicaper la réponse française. Dans les premières analyses faites le 27 juin, on n’évoque pas de massacres. L’offensive du FPR tutsi, avec lequel tout contact doit être évité, est la priorité à Paris. « La bascule de l’analyse française sur la situation à Bisesero s’effectue progressivement dans la journée du 28 juin », écrit la commission. La crédibilité des informateurs sur le terrain devient très douteuse et leur ambiguïté apparaît. Dans la journée du 29, le tableau devient plus clair, le chiffre de 2 000 réfugiés tutsi est dorénavant avancé. Il est bien tard. Pour les avocats des parties civiles, il n’est pas légitime d’éluder l’hypothèse d’une complicité de génocide, dès lors que « le partage de l’intention génocidaire n’est pas nécessairement requis pour qu’une complicité soit retenue ». Le rapport Duclert documente abondamment le soutien politique et militaire français au régime, malgré sa dérive racialiste et haineuse, à compter de la fin 1990. Les avocats des parties civiles poursuivent ainsi leur analyse sur Bisesero : « Les militaires français se trouvaient à proximité immédiate du lieu du crime, étaient pour certains d’entre eux entourés par les auteurs du crime et faisaient de surcroît figure d’autorité aux yeux des tueurs. L’abstention volontaire d’intervenir sur un lieu de massacre peut donc, dans ces conditions, s’analyser comme des actes de complicité de génocide. »Huit personnalités citées
« Un échec et un drame »