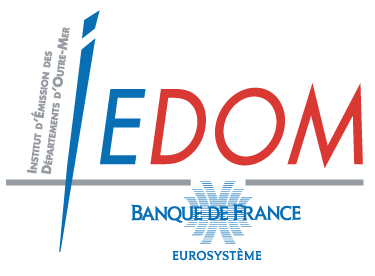Attristée par le décès de Cordo, grand ami d’Aimé Césaire, auprès de qui il fut mon introducteur, car Césaire aimait mes livres et avait exprimé son désir de me rencontrer…
En Martinique, lorsqu’un joueur de sèbi (ou serbi) a fait un six, il s’écrie « Suzanne, ma femme ! » J’ai entendu cela toute ma vie, depuis ma plus tendre enfance, jusqu’à un beau jour où ces mots-là revêtirent une tout autre importance. « Suzanne, ma femme ! » C’est ce qu’Aimé Césaire s’écria en souriant, le jour où son compagnon de route de toujours, le cordial Cordo, alias Félix Cordémy, me présenta au grand homme. Immédiatement Césaire me dit que non seulement mon prénom, mais ma personne même et mon tempérament littéraire évoquaient pour lui cette autre Suzanne, sa femme.
Aujourd’hui Cordo a rejoint Césaire qui gagna naguère, à l’instar de Suzanne, son aimée, le Royaume des Ombres, pour d’improbables prosopopées avec son ami Senghor dans ces Champs Élyséens que nous évoquâmes ensemble, en complices « nègres gréco-latins » férus de Lettres Classiques, lors de l’entretien que Césaire m’accorda pour l’anthologie Prosopopées urbaines, car, pour lui, la Ville c’était Paris, la découverte de Paris, tout jeune encore ; la Ville avec un grand V c’était forcément Paris, car c’est le lieu de sa rencontre avec Senghor.
À quelques mois d’intervalle, j’ai perdu mes deux pères : mon « vrai » père, Osman Dracius, et mon père poétique, Césaire.
 Mais ces ombres, je les veux tutélaires, sans en prendre ombrage, à l’instar des impatiences, ces fleurettes minuscules mais radieuses tapies dans l’ombre des immenses pieds de bois à l’orée de la forêt tropicale humide. Toutefois je me veux verticale comme le nègre césairien « debout les cheveux dans le vent », femme debout comme les fougères arborescentes de la cascade d’Absalon, sur les hauteurs de Balata, traquant sa trace sur la route de la Trace où venaient chercher la fraîcheur Césaire et Suzanne, sa femme, y puisant la source d’une « chlorophyllienne création » ascensionnelle, sensationnelle, telle que je l’idéalise dans Rue Monte au ciel. N’observèrent-ils pas, lors de ces promenades, que l’Antillais est un « homme-plante » ? « Qu’est-ce que le Martiniquais ? — L’homme-plante », écrivit l’aimée de Césaire. Il est vrai que le Martiniquais est capable de vous parler de « la germination de la mort », d’évoquer et d’invoquer Mère Nature non seulement par rapport à la vie, mais aussi en féconde et fertile relation avec la mort.
Mais ces ombres, je les veux tutélaires, sans en prendre ombrage, à l’instar des impatiences, ces fleurettes minuscules mais radieuses tapies dans l’ombre des immenses pieds de bois à l’orée de la forêt tropicale humide. Toutefois je me veux verticale comme le nègre césairien « debout les cheveux dans le vent », femme debout comme les fougères arborescentes de la cascade d’Absalon, sur les hauteurs de Balata, traquant sa trace sur la route de la Trace où venaient chercher la fraîcheur Césaire et Suzanne, sa femme, y puisant la source d’une « chlorophyllienne création » ascensionnelle, sensationnelle, telle que je l’idéalise dans Rue Monte au ciel. N’observèrent-ils pas, lors de ces promenades, que l’Antillais est un « homme-plante » ? « Qu’est-ce que le Martiniquais ? — L’homme-plante », écrivit l’aimée de Césaire. Il est vrai que le Martiniquais est capable de vous parler de « la germination de la mort », d’évoquer et d’invoquer Mère Nature non seulement par rapport à la vie, mais aussi en féconde et fertile relation avec la mort.
En Martiniquaise femme-plante, féminine toujours, en féminitude épanouie, féministe parfois, et cela ne le heurtait pas, m’adonnant au double marronnage – en tant que Martiniquaise qui écrit et en tant que femme qui écrit, car on ne l’attend pas là, loin s’en faut –, je mis en pratique la formule « Marronner, il faut marronner ! » qu’écrivit naguère Césaire à René Depestre, l’encourageant à ne pas se laisser entraver par les aragoniennes contraintes d’une métrique stricte.
En guise de modernes psychopompes, vitalisants, les sourires des étudiants américains d’Ohio University en visite émue dans le bureau de Césaire, impressionnés de rencontrer l’immense chantre de la négritude en toute décontraction et non en grande pompe, sous la houlette de leur professeur, Yolande A. Helm, coordinatrice de l’ouvrage cosmopolite et collectif d’universitaires intitulé Métissages et marronnages dans l’œuvre de Suzanne Dracius.
« Marronner, il faut marronner ! » dixit Césaire depuis marquis d’Antin, ad vitam aeternam.