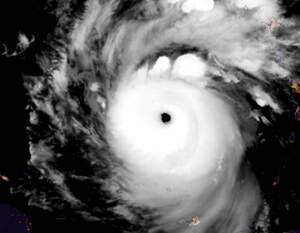Aujourd’hui, nous vous reproposons un document d’archive exceptionnel retravaillé par l’équipe Les-Crises : un entretien vidéo d’Hannah Arendt de 45 minutes sur le totalitarisme, la politique américaine, la raison d’État, la critique du déterminisme historique et le rapport des Juifs à Israël.
Tourné en octobre 1973 (soit 2 ans avant son décès) et diffusé le 6 juillet 1974, ce passionnant entretien, entièrement sous-titré par nos soins (Ndr: par la rédaction du site Lés Crises), correspond au montage final de plus de 8 heures d’échanges avec l’écrivain français Roger Errera.
Parmi les nombreux passages coupés à l’époque, certains ont été restitués à l’écrit dans la New York Review du 26 octobre 1978. Ce document ayant été depuis numérisé, les lecteurs des Crises ont pu vous le traduire en français. On y trouve notamment ce célèbre passage sur les mensonges des gouvernements et l’importance d’une presse libre :
« Dès lors que nous n’avons plus de presse libre, tout peut arriver. Ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c’est que les gens ne sont pas informés ; comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n’êtes pas informé ? Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges mais que plus personne ne croit plus rien.
C’est parce que les mensonges, de par leur nature même, doivent être modifiés, et donc un gouvernement menteur doit constamment réécrire sa propre histoire. En tant que citoyen, vous ne recevez pas seulement un mensonge – que vous pourriez continuer à croire pendant le reste de vos jours – mais vous en recevez un grand nombre, selon la façon dont le vent politique souffle.
Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d’agir mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et l’on peut faire ce que l’on veut d’un tel peuple. »
Les autres paragraphes issus des passages coupés figurent dans la transcription de l’entretien, signalés en italique.
Transcription de l’entretien
Les paragraphes issus des passages coupés sont indiqués en italique.
Née à Hanovre en 1906 dans une famille juive, Hannah Arendt vit aux États-Unis depuis 30 ans. Elle enseigne actuellement la philosophie politique à New-York. Parmi ses livres : Les Origines du totalitarisme, Eichmann à Jérusalem, Condition de l’homme moderne, Du mensonge à la violence.
Roger Errera : Votre premier livre, publié en 1951, a pour titre Les Origines du totalitarisme. Dans ce livre, vous avez voulu non seulement décrire un phénomène mais aussi l’expliquer. D’où cette question : qu’est-ce pour vous que le totalitarisme ?
Hannah Arendt : Je voudrais commencer par faire certaines distinctions sur lesquelles tout le monde n’est pas d’accord. Tout d’abord, une dictature totalitaire n’est ni une simple dictature, ni une simple tyrannie. Lorsque je vois un système totalitaire, j’essaie de l’analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j’essaie d’énumérer ses caractéristiques principales.
Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies, il s’agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n’était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l’histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle quoi qu’elle ait fait par ailleurs. Auparavant, aucun gouvernement n’a tué des gens pour avoir dit oui. Généralement, un gouvernement ou un tyran tuait les gens parce qu’ils disaient non.
Un de mes amis m’a rappelé qu’une idée très similaire avait été énoncée en Chine il y a plusieurs siècles : les hommes qui ont l’impertinence d’approuver ne valent pas mieux que ceux qui désobéissent et s’opposent. C’est là, bien évidemment, l’essence du totalitarisme, le fait qu’il y ait une totale domination de l’homme par l’homme. En ce sens, il n’y a pas aujourd’hui de totalitarisme, même en Russie où règne pourtant la pire des tyrannies que nous ayons jamais connue. Il faut faire quelque chose pour qu’on vous envoie en exil, ou dans un camp de travail, ou dans un asile psychiatrique.
Regardons un moment ce qu’est une tyrannie. Les régimes totalitaires sont toujours nés lorsque la majorité des pays européens étaient déjà soumis à une dictature. La dictature dans le sens original du concept et du mot n’est pas une tyrannie, c’est une suspension temporaire des lois en cas d’urgence, généralement pendant une guerre ou une guerre civile. La dictature est limitée dans le temps, la tyrannie ne l’est pas.
Le totalitarisme commence par le mépris de ce que vous avez. La deuxième étape est la notion : « Les choses doivent changer – peu importe comment, Tout est mieux que ce que nous avons. » Les dirigeants totalitaires organisent ce genre de sentiment de masse, et en l’organisant, l’articulent, et en l’articulant, ils font en sorte que les gens l’aiment d’une certaine manière.
On leur a dit auparavant : Tu ne tueras point ; et ils ne tuaient pas. Maintenant on leur dit : tu tueras ; et bien qu’ils pensent qu’il est difficile de tuer, ils le font car cela fait maintenant partie du code de conduite. Ils apprennent qui tuer et comment tuer et comment le faire ensemble.
C’est le Gleichschaltung, le processus de coordination, dont on parle beaucoup. Vous n’êtes pas coordonné avec les pouvoirs en place, mais avec votre voisin, coordonné avec la majorité. Mais au lieu de communiquer avec l’autre, vous êtes désormais collé à lui. Et vous vous sentez bien sûr merveilleusement bien. Le totalitarisme fait appel aux besoins émotionnels très dangereux des personnes qui vivent dans un isolement complet et dans la peur de l’autre.
Ce sont des choses très importantes auxquelles il faut prêter attention. Lorsque j’ai écrit mon livre sur Eichmann à Jérusalem, l’un de mes principaux objectifs était de détruire la légende de la grandeur du mal, de la force démoniaque, de retirer aux gens l’admiration qu’ils ont pour les grands malfaiteurs comme Richard III. J’ai trouvé dans Brecht la réflexion suivante : « Les grands criminels politiques, doivent à tout prix être mis à nu, et surtout être livrés au ridicule.
Ce ne sont pas de grands criminels politiques mais des hommes qui ont commis de grands crimes politiques, ce qui est quelque chose d’entièrement différent. L’échec d’Hitler n’indique pas qu’il était imbécile. » [1] Le fait qu’Hitler était un imbécile était une idée courante et fausse dans toute l’opposition avant qu’il ne prenne le pouvoir. De nombreux livres ont essayé ensuite de le justifier et d’en faire un grand homme. Il dit donc : « Le fait qu’il ait échoué n’indique pas qu’Hitler était un imbécile, et l’envergure de ses entreprises n’en fait pas un grand homme. » Ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est-à-dire que toute cette notion de grandeur n’a pas d’application.
« Si les classes dirigeantes, dit Brecht, permettent à un petit escroc de devenir un grand escroc, il n’a pas droit à une position privilégiée dans l’histoire. » C’est-à-dire que le fait qu’il devienne un grand escroc et que ce qu’il fait a des conséquences graves ne le grandit pas. Puis il dit : « Sur un plan général et de façon abrupte, on peut dire que la tragédie traite des souffrances de l’humanité d’une façon moins sérieuse que la comédie. »
Ceci est évidemment une déclaration choquante, mais en même temps, je pense qu’elle est parfaitement juste. Si l’on veut garder son intégrité en de telles circonstances, on ne peut le faire que si l’on se souvient : quoi qu’il fasse et même s’il a tué dix millions de personnes, ce n’est qu’un clown.
Roger Errera : Lorsque vous avez publié votre livre sur le procès Eichmann, cet ouvrage a provoqué des réactions très violentes. Pourquoi cette réaction ?
Hannah Arendt : Cette controverse était due en partie au fait que j’avais attaqué la bureaucratie. Si l’on attaque une bureaucratie, il faut s’attendre à ce qu’elle se défende, qu’elle vous attaque, qu’elle essaie de vous rendre la vie impossible. C’est plus ou moins une vilaine affaire politique. Cela, je pouvais le comprendre.
Mais supposons qu’ils n’aient pas organisé cette campagne. Malgré cela, l’opposition à ce livre aurait été très forte parce que des Juifs ont été offensés, et par là je veux dire des personnes que je respecte vraiment et que je peux comprendre. Ils étaient surtout offensés par ce que dit Brecht, par le rire. Mon rire, à ce moment-là, était plus ou moins innocent. Je n’y pensais pas.
Ce que je voyais, c’est qu’Eichmann était un clown. Eichmann, par exemple, ne s’est jamais reproché ce qu’il avait fait aux Juifs. Il se reprochait un incident : il avait giflé le président de la communauté juive de Vienne pendant son interrogatoire. Dieu sait que bien des gens subissaient des traitements bien pires que celui-là, pourtant Eichmann ne se l’est jamais pardonné. Il avait cédé à une impulsion et il pensait que c’était très mal d’avoir perdu son sang-froid.
Roger Errera : Pourquoi pensez-vous que nous voyons en effet apparaître toute une littérature qui, s’agissant notamment du nazisme, décrit de façon souvent romancée ses chefs, leurs forfaits, et essaye de les humaniser, somme toute, et ainsi indirectement de les justifier ? Pensez-vous que de telles publications aient une raison purement commerciale ou pensez-vous qu’elles aient une signification plus profonde ?
Hannah Arendt : Je pense qu’elles ont une signification. Elles montrent au moins que ce qui s’est passé une fois peut arriver à nouveau. La tyrannie est connue depuis très longtemps, c’est depuis très longtemps un ennemi. Cela n’a pourtant jamais empêché un tyran de devenir un tyran. Cela n’a empêché ni Néron ni Caligula. Et Néron et Caligula n’ont pas empêché des exemples récents tels que l’intrusion massive de la criminalité dans la vie politique.
Roger Errera : Vous êtes arrivée dans ce pays [les États-Unis] en 1941, vous veniez d’Europe. Vous y vivez donc depuis 32 ans. Quand vous arriviez en Europe, quelle était votre impression dominante ?
Hannah Arendt : Mon impression dominante, c’est que l’Amérique n’est pas un État-nation. Les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu’ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n’est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique. Il n’y a pas d’Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c’est beaucoup : on devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution.
La Constitution, du point de vue français ou allemand n’est qu’un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c’est un document sacré. C’est le souvenir constant d’un acte unique et sacré, l’acte de fondation des États-Unis. Sa fondation a consisté à réunir en un tout des minorités ethniques et des régions entièrement disparates, sans pour autant niveler et faire disparaître ces différences.
Tout cela est très difficile à comprendre pour un étranger. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c’est la loi qui règne et non pas les hommes. Jusqu’à quel point ceci est vrai et a besoin d’être vrai pour le bien du pays, j’ai failli dire de la nation, pour le bien de l’ensemble des États-Unis d’Amérique, pour la république, à vrai dire…
Roger Errera : Durant les dix années qui viennent de s’écouler, l’Amérique a connu une vague de violence politique marquée par l’assassinat du président, de son frère, par la guerre du Vietnam, par l’affaire du Watergate. Pourquoi l’Amérique peut-elle surmonter des crises qui en Europe auraient abouti à des changements de régime, voire à des troubles intérieurs très graves ?
Hannah Arendt : L’affaire du Watergate a révélé l’une des plus profondes crises constitutionnelles que l’Amérique a jamais connue. Cette crise constitutionnelle représente pour la première fois aux États-Unis un conflit ouvert entre le législatif et l’exécutif. Ici, c’est la Constitution elle-même qui est en partie responsable.
Les Pères fondateurs ne pensaient pas que la tyrannie puisse surgir de l’exécutif, parce qu’ils ne voyaient dans celui-ci rien d’autre que la simple exécution de ce qu’avait décidé le législateur, sous des formes variées, je m’en tiens là. Nous savons aujourd’hui que le plus grand danger de tyrannie vient de l’exécutif.
Mais si nous prenons à la lettre l’esprit de la Constitution, que pensaient les Pères fondateurs ? Ils pensaient s’être libérés d’abord de la domination de la majorité, c’est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Une erreur que de nombreux Américains partagent. Ce que nous avons ici, c’est un système républicain. Les Pères fondateurs s’attachaient surtout à préserver les droits des minorités parce qu’ils estimaient que dans un corps politique sain, il doit y avoir une pluralité d’opinions.
Ce que les Français appellent l’Union sacrée était précisément pour eux ce dont il ne fallait pas. Ce serait déjà une sorte de tyrannie, et le tyran pourrait très bien être une majorité. Par conséquent, le système politique tout entier est organisé de telle façon que même après la victoire de la majorité, il y a toujours une opposition. Cette opposition est nécessaire car elle représente les opinions légitimes d’une ou de plusieurs minorités.
La sécurité nationale est une notion nouvelle dans le vocabulaire américain. C’est vraiment, si je peux l’interpréter un peu, la traduction de raison d’État. Cette notion de raison d’État n’a jamais joué aucun rôle en Amérique. C’est une nouvelle importation.
La sécurité nationale couvre maintenant toutes sortes de délits. Par exemple, le président a tous les droits. Il est au-dessus de la loi. Le roi ne peut se tromper, c’est-à-dire qu’il est comme un monarque dans une république. Il est au-dessus de la loi, et sa justification est toujours que quoi qu’il fasse, il le fait en vue de la sécurité nationale.
Roger Errera : En quoi selon vous ces implications modernes de la raison d’État, ce que vous appelez l’« intrusion de la criminalité dans le domaine politique », est-elle propre à notre temps ? Est-ce que ceci est propre à notre époque ?
Hannah Arendt : C’est propre à notre époque, c’est vraiment ce que je pense. Tout comme le commerce apatride est propre à notre époque et se perpétue sous différent aspects, sous des genres différents et des couleurs différentes. Mais si nous en venons à ces questions générales, ce qui est également propre à notre époque, c’est l’intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes que l’on cherche toujours à justifier par la raison d’État en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d’action politique qui est en lui-même criminel.
Ce n’est plus une exception à règle. Ils ne disent pas : « Nous sommes dans une situation d’une telle urgence qu’il nous faut brancher tout le monde sur une table d’écoute, y compris le président lui-même ». Ici, la table d’écoute fait partie du procédé politique normal. Ils ne disent pas non plus : « Nous cambriolons exceptionnellement les bureaux d’un psychiatre, et nous ne le ferons jamais plus », absolument pas. Ils affirment au contraire qu’une telle effraction est absolument légitime.
Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d’État. Cette notion de sécurité nationale que l’on invoque est directement importée d’Europe centrale. Bien sûr, les Allemands, les Français et les Italiens la reconnaissent comme entièrement justifiée parce qu’ils ont toujours vécu sous cette règle. Mais c’était précisément l’héritage européen que la Révolution américaine avait l’intention de briser.
Roger Errera : Dans votre essai consacré aux documents du Pentagone [2], vous décrivez la psychologie de ceux que vous appelez les « spécialistes de la solution des problèmes », qui étaient à l’époque les conseillers du gouvernement américain. Et vous dites : « Les spécialistes de la solution des problèmes ont été définis comme des hommes très sûrs d’eux-mêmes et qui semblent rarement douter de leur aptitude à s’imposer. Ils ne se contentaient pas de faire preuve d’intelligence, mais se targuaient en même temps de leur rationalisme, de leur amour de la théorie, de l’univers purement intellectuel, leur faisant rejeter tout sentimentalisme à un point assez effrayant. »
Hannah Arendt : Est-ce que je peux vous interrompre ici ? Je pense que cela suffit. J’ai un très bon exemple. Dans les documents du pentagone, il y a un très bon exemple de cette mentalité scientifique envahissante. Vous connaissez la théorie des dominos qui était la théorie officielle tout au long de la guerre froide, de 1950 à 1969, peu de temps après les documents du Pentagone.
La « théorie des dominos » est un bon exemple du type de mentalité scientifique qui écrase toutes les autres idées.
La vérité est que parmi les intellectuels très sophistiqués qui avaient écrit les documents du Pentagone, très rares étaient ceux qui croyaient en cette théorie des dominos. Aux plus hauts postes du gouvernement, il n’y avait que deux ou trois personnes qui y croyaient vraiment, W. Rostow et, je ne sais pas, le général Taylor, et ce n’étaient pas exactement parmi les plus intelligents. En fait, ils n’y croyaient même pas, mais toutes leurs actions s’en tenaient à cette théorie.
Ils n’agissaient pas par mensonge ou parce qu’ils voulaient se faire bien voir de leurs supérieurs, ils convenaient bien, mais parce que cela leur donnait un cadre dans lequel ils pouvaient travailler. Ils avaient adopté ce cadre tout en sachant qu’il était en contradiction avec les événements et les analyses qui leur prouvaient chaque matin que ce point de vue était tout simplement faux. Ils l’ont adopté parce qu’ils n’avaient pas d’autre cadre.
Les gens trouvent de telles théories afin de se débarrasser de la contingence et de l’imprévisible. Le bon vieux Hegel a dit un jour que toute contemplation philosophique ne sert qu’à éliminer l’accidentel. Un fait doit être attesté par des témoins oculaires qui ne sont pas les meilleurs des témoins ; aucun fait n’est incontestable. Mais que deux et deux font quatre ne fait aucun doute. Et les théories produites au Pentagone étaient toutes beaucoup plus plausibles que ce qui s’est réellement passé.
Roger Errera : Notre siècle me semble dominé par une persistance de modes de pensée fondés sur le déterminisme historique.
Hannah Arendt : Il y a de très bonnes raisons à cette croyance en la nécessité historique.
La principale caractéristique de tout évènement est qu’il n’a pas été prévu.
Nous ne connaissons pas l’avenir. Tout le monde agit en vue de l’avenir et personne ne sait ce qu’il fait parce que l’avenir se fait. L’action est faite par nous et non pas par moi. Ce n’est que lorsque j’agis seule, si j’étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s’est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l’un des plus grands facteurs de l’histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu’il y a tant de choses qui dépendent d’une énorme quantité de facteurs variables, c’est-à-dire du hasard.
Par contre, si l’on regarde l’histoire, rétrospectivement on peut dire que l’histoire est logique.
L’histoire juive, par exemple, a en fait eu ses hauts et ses bas, ses inimitiés et ses amitiés, comme toute histoire de tous les peuples. L’idée qu’il existe une histoire unilinéaire est bien sûr fausse. Mais si vous la regardez après l’expérience d’Auschwitz, il semble que toute l’histoire – ou du moins l’histoire depuis le Moyen-Âge – n’ait pas eu d’autre but qu’Auschwitz…
Comment cela a-t-il été possible ? C’est le véritable problème de toute philosophie de l’histoire. Comment est-il possible qu’après coup il semble toujours que les choses n’auraient pas pu se passer autrement ? Toutes les variables ont disparu, et la réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d’envisager une variété infinie de possibilités.
Roger Errera : Mais si nos contemporains conservent leur attachement à des modes de pensée déterministes, malgré les démentis de l’histoire, serait-ce d’après vous parce qu’ils ont peur de la liberté, parce qu’ils ont peur de l’imprévu ?
Hannah Arendt : Oui, bien sûr, mais ils ne le disent pas. S’ils le disaient, on pourrait immédiatement ouvrir le débat. Si seulement ils disaient : « nous avons peur », par exemple. « Nous avons peur d’avoir peur. » C’est l’une des principales motivations. Mais nous avons peur de la liberté.
Roger Errera : Est-ce que vous imaginez en Europe un ministre, voyant sa politique sur le point d’échouer, commander à une équipe d’experts extérieurs à l’administration une étude dont le but serait de savoir les décisions…
Hannah Arendt : Pas extérieurs de l’administration. Ils venaient de partout, et aussi de…
Roger Errera : C’est cela, mais également avec des personnes extérieures à l’administration. Est-ce que donc vous imaginez un ministre européen dans la même situation commander une telle étude pour savoir comment cela est arrivé ?
Hannah Arendt : Bien sûr que non.
Roger Errera : Pourquoi ?
Hannah Arendt : À cause de la raison d’État. Il aurait immédiatement commencé à dissimuler ses erreurs. L’attitude de McNamara était différente. J’ai cité au début de mon essai sur les documents du Pentagone l’un de ses propos : « Ce n’est pas un très joli spectacle que de voir la première des superpuissances tuer ou blesser chaque semaine des milliers de non combattants. Comment en sommes-nous arrivés là ? » [3] C’est là une attitude américaine et cela montre que la situation était encore saine parce qu’il y avait encore un McNamara qui voulait en tirer un enseignement.
Roger Errera : Pensez-vous qu’actuellement les dirigeants américains placés devant d’autres situations aient encore l’envie de savoir ?
Hannah Arendt : Non. Je ne pense pas qu’il en reste un seul. Je ne sais pas. Non, non, non, je retire ce que j’ai dit. Je crois, si je ne me trompe, que McNamara était sur la liste des ennemis de Nixon, je l’ai lu aujourd’hui dans le New-York Times. Je pense que c’est vrai. Cela vous montre déjà que toute cette attitude n’existe plus dans la vie politique américaine au niveau le plus élevé. Ces gens-là croyaient déjà à l’image qu’il fallait créer de soi, mais en se disant : « pourquoi n’avons-nous pas réussi à nous créer une image ? » Et on pourrait dire qu’il ne s’agissait que d’image. Mais maintenant ils veulent que tout le monde croie à leur image et que personne ne regarde au-delà. Nous entrons alors dans un univers politique tout à fait différent.
Roger Errera : Et donc après ce que le sénateur Fullbright appelait l’« arrogance du pouvoir », après ce que l’on pourrait nommer l’arrogance du savoir, un troisième stade qui serait l’arrogance tout court.
Hannah Arendt : Oui. Je ne sais pas si c’est l’arrogance tout court. C’est plutôt la volonté de dominer. Jusqu’à présent cela n’a pas réussi. Je peux encore aujourd’hui m’asseoir à cette table et vous parler librement, donc ils ne m’ont pas encore dominée et je n’ai pas peur. J’ai peut-être tort. Je me sens parfaitement libre dans ce pays. Quelqu’un, Morgenthau je crois, a appelé toute l’entreprise de Nixon la « révolution avortée ». Nous ne savons pas encore si elle a avorté, il a peut-être dit cela de façon prématurée, mais on peut certainement dire une chose : elle n’a pas non plus été couronnée de succès.
Roger Errera : Mais ce qui menace, à notre époque, c’est l’idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l’idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce que, à notre époque, l’arrivée au pouvoir d’hommes, de mouvements, qui s’assignent des objectifs illimités n’est pas la plus grande menace ?
Hannah Arendt : J’espère que je ne vous choquerais pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d’être une libérale. Je n’ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en « isme ».
Roger Errera : Certainement, mais c’est tout de même à l’intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l’antiquité, que se situe votre réflexion philosophique.
Hannah Arendt : Diriez-vous que Montesquieu est un libéral ? Diriez-vous que tous ceux dont je tiens compte et qui ont un peu de valeur… Moi, je me sers où je peux. Je prends ce que je peux et ce qui me convient. L’un de grands avantages de notre temps, c’est ce qu’a dit René Char : « Notre héritage n’est garanti par aucun testament. »
Roger Errera : « précédé par aucun testament. »
Hannah Arendt : « n’est précédé par aucun testament. » [4] Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d’utiliser où que nous le voulions, les expériences et les pensées du passé.
Roger Errera : Mais est-ce que cette liberté extrême ne risque pas d’effrayer beaucoup de nos contemporains qui préféreraient trouver toute prête une théorie, une idéologie et être en mesure de l’appliquer ?
Hannah Arendt : Certainement. Aucun doute.
Roger Errera : Cette liberté que vous définissez, cela risque d’être la liberté de quelques-uns, de ceux qui auront la force d’inventer de nouveaux modes de pensée ?
Hannah Arendt : Non. Non. Elle ne repose que sur la conviction que chaque être humain, en tant qu’être pensant, peut réfléchir aussi bien que moi, et peut former son propre jugement s’il le veut. Ce que je ne sais pas, c’est comment faire naître ce désir en lui. Je ne suis pas une propa…
La seule chose qui peut vraiment nous aider, c’est vraiment de réfléchir. Réfléchir, cela signifie de toujours penser de manière critique. Et penser de manière critique, cela signifie que chaque pensée sape ce qu’il y a en fait de règles rigides, et de convictions générales. Tout ce qui se passe lorsqu’on pense est soumis à un examen critique. C’est-à-dire qu’il n’existe pas de pensée dangereuse, pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Mais ne pas penser est encore plus dangereux. Je ne nie pas le fait que réfléchir est dangereux, mais ne pas réfléchir, c’est plus dangereux, encore.
Roger Errera : Revenons à ce mot de René Char : « Notre héritage n’est précédé d’aucun testament. » Quel est d’après vous l’héritage du XXe siècle ?
Hannah Arendt : Nous sommes encore là. Vous êtes jeune, je suis âgée, mais nous sommes encore là tous les deux pour leur laisser quelque chose.
Roger Errera : Justement, que laisserons-nous au XXIe siècle ? Les trois quarts du siècle sont déjà écoulés.
Hannah Arendt : Je n’en sais rien. Je suis à peu près certaine qu’il y aura l’art moderne, qui stagne plutôt actuellement. Mais après la grande créativité des quarante premières années de ce siècle, notamment en France, il est naturel qu’il se produise un certain épuisement. Ce XXe siècle sera probablement l’un des grands siècles de l’Histoire, mais pas en politique.
Roger Errera : Vous avez traité à plusieurs reprises dans votre œuvre de l’histoire moderne des Juifs et de l’antisémitisme. Vous dites à la fin de l’un de vos ouvrages que la naissance du mouvement sioniste à la fin du XIXe siècle a été la seule réponse politique que les Juifs aient jamais trouvée à l’antisémitisme [5]. En quoi l’existence d’Israël a changé le contexte politique et psychologique dans lequel vivent les Juifs dans le monde ?
Hannah Arendt : Je crois que cela a tout changé. Aujourd’hui, le peuple juif est vraiment uni derrière Israël [6]. Ils sentent qu’ils ont un État, une représentation politique, tout comme les Irlandais, les Anglais ou les Français. Ils ont non seulement une patrie, mais ils ont un État-nation et leur attitude toute entière envers les Arabes dépend pour une grande part d’une identification que les Juifs venant d’Europe centrale ont toujours faite instinctivement et sans réfléchir. L’État doit être nécessairement un État-nation.
Les relations entre la diaspora et Israël, ou ce qui antérieurement était la Palestine, ont changé parce qu’Israël n’est plus simplement un refuge pour Juifs polonais. Un sioniste était alors un homme qui essayait d’obtenir de l’argent des Juifs riches pour les pauvres Juifs polonais. Mais aujourd’hui, Israël est le représentant du peuple juif dans le monde entier. Que cela nous plaise ou non, c’est une autre question. Cela ne signifie pas que le judaïsme de la diaspora doit toujours être du même avis que le gouvernement israélien. Ce n’est pas une question de gouvernement, c’est une question d’État. Tant que cet État existera, il sera évidemment ce qui nous représente aux yeux du monde.
Roger Errera : Justement, un auteur français, Georges Friedmann a écrit, il y a une dizaine d’années, un livre intitulé Fin du peuple juif ? [7] où il concluait qu’à l’avenir il y aurait d’un côté un nouvel État, la nation israélienne, et de l’autre côté, dans les pays de la diaspora, des Juifs qui s’assimileraient et perdraient peu à peu leurs caractéristiques propres.
Hannah Arendt : Cette hypothèse semble très plausible et je crois qu’elle est tout à fait fausse. Dans l’antiquité, lorsque l’État juif existait encore, il y avait déjà une grande diaspora juive. Au cours des siècles, à travers un très grand nombre de formes différentes de gouvernements et d’États, les Juifs, le seul peuple de l’antiquité qui ait survécu à travers les millénaires, n’ont jamais été assimilés.
Si les Juifs avaient pu être assimilés, il y a longtemps qu’ils l’auraient été. Il y a eu une occasion pendant la période espagnole, il y en a eu une autre pendant la période romaine, puis évidemment au XVIIIe et au XIXe siècle. Un peuple, une collectivité, ne se suicide pas. M. Friedmann se trompe parce qu’il ne comprend pas que le sentiment des intellectuels qui peuvent changer, en effet, de nationalité et absorber une autre culture, ne correspond pas au sentiment du peuple dans son ensemble, et particulièrement pas à celui d’un peuple qui a été créé par des lois que nous connaissons.
Le « talent » – pour ainsi dire – d’une certaine partie au moins du peuple juif est un problème historique, un problème de premier ordre pour les historiens. Je peux risquer une explication spéculative : nous sommes le seul peuple, le seul peuple européen, qui a survécu depuis l’Antiquité et pratiquement intact.
Cela signifie que nous avons conservé notre identité, et que nous sommes les seuls à n’avoir jamais connu l’analphabétisme. Nous avons toujours été alphabétisés parce qu’on ne peut pas être juif sans être alphabétisé. Les femmes étaient moins alphabétisées que les hommes, mais même elles étaient beaucoup plus alphabétisées que leurs homologues ailleurs. Non seulement l’élite savait lire, mais chaque Juif devait lire – le peuple entier, dans toutes ses classes et à tous les niveaux de talent et d’intelligence.
Roger Errera : Que signifie pour les Juifs l’assimilation dans la société américaine ?
Hannah Arendt : Dans le sens d’une assimilation des Juifs à leur environnement, il n’y a pas d’assimilation à une culture. Voulez-vous avoir l’obligeance de me dire à quoi les Juifs devraient s’assimiler, ici ? Aux Anglais, aux Irlandais, aux Allemands, aux Français, à quiconque qui soit venu ?
Roger Errera : Lorsque l’on dit que les Juifs américains sont très américanisés, non seulement américains mais américanisés, à quoi fait-on allusion ?
Hannah Arendt : On pense au style de vie. Tous ces Juifs sont d’excellents citoyens Américains. Cela signifie leur vie publique, pas leur vie privée, pas leur vie sociale. Leur vie privée et leur vie sociale sont aujourd’hui plus juives qu’elles ne l’ont jamais été. Ainsi, un grand nombre de jeunes apprennent l’hébreu, même si leurs parents l’ont oublié depuis longtemps.
Mais l’essentiel, c’est Israël. Est-on pour ou contre Israël ? Prenez par exemple les Juifs allemands de ma propre génération qui ont émigré aux États-Unis. En très peu de temps, ils sont devenus des Juifs très nationalistes, beaucoup plus nationalistes que je ne l’ai jamais été, en dépit du fait que j’étais, moi, sioniste, et qu’ils ne l’étaient pas. Je n’ai jamais dit : « je suis allemande », j’ai toujours dit : « je suis juive ». Mais maintenant, à quoi s’assimilent-ils ? À la communauté juive. Puisqu’ils étaient habitués à l’assimilation, ils se sont assimilés à la communauté juive d’Amérique. Avec la ferveur de nouveaux convertis, ils sont devenus ultra-nationalistes et pro-Israéliens.
Roger Errera : À travers l’histoire, ce qui a assuré la survie du peuple juif, cela a été essentiellement un lien de nature religieuse. Nous sommes à une époque où l’ensemble des religions connaissent une crise, et où le lien religieux tend à s’affaiblir. Dans ces conditions, qu’est-ce qui, à l’époque contemporaine, fait l’unité du peuple juif à travers le monde ?
Hannah Arendt : Je crois qu’ici vous vous trompez légèrement. Lorsque vous dites « religion », vous pensez évidemment à la religion chrétienne qui est un credo, une croyance, une foi. Cela n’est absolument pas le cas pour la religion juive. C’est une religion nationale dans laquelle religion et nation coïncident. Vous savez que les Juifs, par exemple, ne reconnaissent pas le baptême des Juifs convertis au christianisme ? Tout se passe comme si cet acte n’existait pas.
D’après la loi juive, un Juif reste toujours juif. Aussi longtemps que quelqu’un est né d’une mère juive, la recherche de la paternité est interdite, c’est un Juif. La notion de religion est complètement différente. Il s’agit beaucoup plus d’un mode de vie que d’une religion dans le sens particulier et spécifique de la religion chrétienne. J’ai eu une éducation juive et je me souviens lorsque j’avais environ 14 ans, je me suis révoltée contre notre professeur et j’ai voulu le choquer. Je me suis levée et j’ai dit : « Je ne crois pas en Dieu. » Il m’a alors répondu : « Personne ne vous le demande. »
Notes
[1] Bertolt Brecht, « Bemerkungen » dans Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, cf. Brecht, Werke (GroBe kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe), v. 24, pp. 315-319.
[2] Hannah Arendt, « Lying in Politics: Reflections on the Pentagon Papers », The New York Review of Books (18 novembre 1971), pp. 30-39; Pour l’édition française, cf. note 6 dans « Interviewing Hannah Arendt »; Édition allemande : « Die Luge in der Politik: Uberlegungen zu den PentagonPapieren », Die neue Rundschou (v. 83, no. 2 [1972]), pp. 185-213.
[3] La citation de Robert S. McNamara qu’Arendt a prise comme slogan dans « Lying in Politics » se lit comme suit : « L’image de la plus grande superpuissance du monde tuant ou blessant gravement un millier de non combattants par semaine, alors qu’elle tente de pilonner et soumettre une minuscule nation arriérée sur une question dont les mérites sont vivement contestés, n’est pas belle à voir. » [« The picture of the world’s greatest superpower killing or seriously injuring a thousand non-combatants a week, while trying to pound a tiny backward nation into submission on an issue whose merits are hotly disputed, is not a pretty one. »]
[4] René Char : « Notre héritage n’est précédé par aucun testament. » L’aphorisme est tiré de « René Char, Feuillets d’Hypnos », no. 62 voir R. Char, Œuvres complètes (Paris: Gallimard, 1983), p. 190; cf. Hannah Arendt dans sa « Preface » à « Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought » (New York: Viking), 1968.
[5] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, new edition with added prefaces (San Diego etc. : A Harvest I HBJ Book, 1979), p. 120.
[6] Cette déclaration et les suivantes doivent être lues dans le contexte des événements de la journée. Le 6 octobre 1973, l’Égypte et la Syrie ont attaqué Israël, déclenchant la guerre d’octobre [guerre du Kippour].
[7] Georges Friedmann, Fin du peuple juif ? (Paris : Gallimard, 1965).