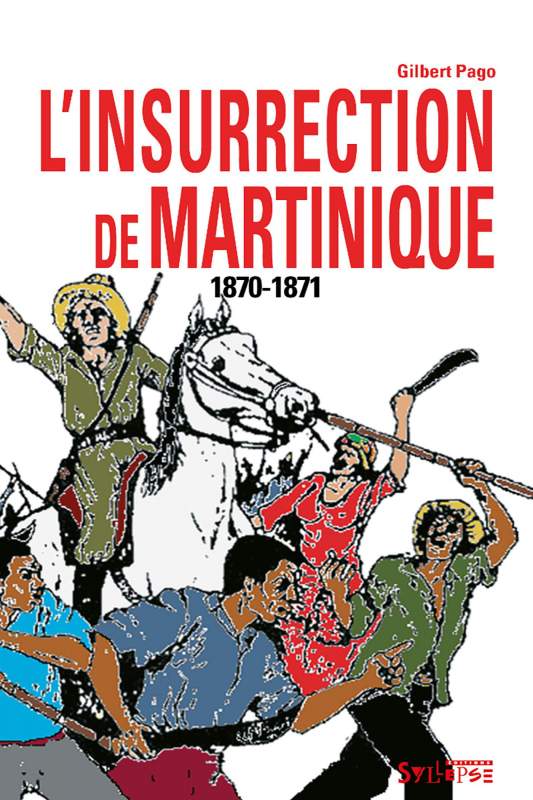Gilbert Pago, L’insurrection de Martinique (1870-1871)
Référence(s) :
Gilbert Pago, L’insurrection de Martinique (1870-1871), Paris, Éditions Syllepse, 2011, 154 p.
1«Une commune de Paris en terre coloniale ? ». La phrase d’accroche de la quatrième de couverture du livre de Gilbert Pago a sans doute sa raison d’être, disons « commerciale ». Mais il n’est pas sûr que la question elle-même soit bien pertinente. Certes, il y a un contexte commun : celui de l’effondrement du Second Empire, de la défaite de Sedan et de la proclamation de la IIIe République. Certes, il y a la rencontre de certains des vaincus dans les bagnes de Nouvelle-Calédonie. Mais l’insurrection de septembre 1870 en Martinique, outre qu’elle est antérieure de six mois à la Commune, n’a guère eu le temps de mettre en place ne serait-ce qu’un embryon d’organisation pour mettre en oeuvre un projet de démocratie sociale.
Elle fut, en effet, au bout de cinq jours, écrasée dans le sang par les troupes de marine, aidées de volontaires blancs. Restent alors les espoirs brisés d’un peuple qui, là-bas aussi, rêvait de bien-être et d’égalité. Mais cette histoire-là n’est pas propre à la révolte martiniquaise et à la Commune. Elle est universelle.
2La comparaison nous semble ici d’autant moins utile qu’elle pourrait conduire à masquer les ressorts spécifiquement coloniaux du soulèvement antillais, produit d’un passé récent esclavagiste qui pesait encore lourdement sur les mentalités et les comportements. L’auteur ne s’y trompe d’ailleurs pas, qui envisage son livre comme un moyen de « revisiter les rouages » d’un monde qui, s’il n’était plus esclavagiste, « n’en restait pas moins violent, ségrégationniste et inhumain pour ses parias ». Le feu couvait en effet depuis longtemps sous la cendre des promesses anéanties de 1848. Transformés en travailleurs forcés attachés à un patron, les paysans noirs sont ainsi passés du statut d’esclaves à celui de quasi-serfs. Ils étaient accablés par l’impôt personnel frappant les anciens esclaves et soumis à la concurrence d’une main d’oeuvre étrangère (indienne et chinoise, notamment) qui permettait aux employeurs de maintenir la pression sur leurs salaires. Ils n’avaient enfin même pas la perspective d’offrir une vie meilleure pour leurs enfants, les écoles créées après 1848 ayant été depuis fermées ou rendues payantes.
3À cela s’ajoutaient les humiliations répétées d’une élite blanche imbue de préjugés raciaux. C’est d’ailleurs l’une d’entre elles qui fournit à l’insurrection son étincelle. En février 1870, entre Le Marin et Rivière Pilote, dans le sud de l’île, un Européen fréquentant les cercles békés brutalise Léopold Lubin, un jeune Noir, qui porte plainte. L’affaire est classée sans suite et Lubin décide donc de se faire justice lui-même deux mois plus tard, en rouant de coups son agresseur. Arrêté, le jeune homme est condamné au mois d’août à cinq ans de bagne, par un jury acquis au clan béké et comptant dans ses rangs un certain Codé, monarchiste connu pour ses provocations et ses déclarations pro-esclavagistes. Très vite, la population noire s’organise pour obtenir la libération de Lubin : une souscription est lancée pour payer l’amende et le pourvoi en cassation tandis qu’un « cercle de jeunes » est formé autour d’Auguste Villard, mulâtre et instituteur à Rivière Pilote, dans le but de faire pression sur les autorités. Les esprits sont échauffés par le sentiment d’injustice, par les bravades de Codé se vantant de son rôle dans la condamnation de Lubin, ainsi que par les rumeurs d’une défaite imminente de l’Empire. Aussi, lorsque le 22 septembre 1871, le maire de Rivière Pilote proclame solennellement la République devant ses administrés rassemblés, l’agitation de la foule se transforme-t-elle rapidement en émeute, puis en insurrection, prenant tout le monde au dépourvu.
4Pour spontanée qu’elle fût, cette révolte – qui n’a touché que la partie méridionale de la Martinique – n’était pas dénuée de contenu sociopolitique. L’un de ses chefs, Louis Telga, qui s’était rendu maître du bourg de Rivière Pilote, exigeait bien sûr la libération de Lubin, tandis qu’un autre, le quimboiseur (guérisseur) Eugène Lacaille, y ajoutait un mot d’ordre de partage des terres appartenant aux békés et de revalorisation des salaires dans les plantations. Ces revendications ont eu pour effet de souder les ardeurs des ruraux, petits planteurs et ouvriers agricoles, qui fournirent le gros de la troupe insurgée. Mais elles ne parvinrent pas à mobiliser véritablement la petite bourgeoisie de couleur ou les mulâtres. Ces derniers, bien que confinés dans des rôles de citoyens de seconde zone, exclus des carrières les plus prestigieuses et de toute représentation politique, ne se rallièrent pas au mouvement, choisissant prudemment « l’ordre et la loi », dans la perspective d’une assimilation républicaine. La stratégie défensive des insurgés qui se replièrent dans les campagnes laissa l’initiative à l’armée gouvernementale et aux milices blanches. Les chassepots des militaires firent le reste, face aux mauvais fusils de chasse, aux coutelas et aux bambous des révoltés. La répression, attisée par la haine et la rancœur des volontaires blancs, se mua dès lors en véritable boucherie et l’auteur affirme qu’il n’est pas possible d’en dénombrer les victimes.
5S’ouvre ensuite une seconde partie du livre, très intéressante, qui s’appuie sur les archives des deux premières séries de procès qui eurent lieu dans le courant de l’année 1871. C’est l’occasion d’abord de dresser un portrait collectif des insurgés, paysans pour la plupart, jeunes (moins de 40 ans) le plus souvent, des hommes certes, mais aussi des femmes. Celles-ci montaient parfois en première ligne dans les combats et certaines jouèrent un rôle de meneuse, comme cette Lumina Sophie, incendiaire d’habitations et blasphématrice, que Gilbert Pago dépeint comme une figure de proue de la révolte. Ces chapitres illustrent aussi les dysfonctionnements d’une justice de classe et de caste, entre les partis pris d’une instruction qui s’obstina à démontrer l’existence d’une pseudo-conspiration indépendantiste et la désinvolture des avocats des insurgés qui refusèrent de plaider pour « cette foule lâche…, réfractaire à toute civilisation ». En filigrane, c’est aussi un portrait de l’élite coloniale blanche qui se dessine, un portrait où le machisme le dispute au racisme. Les femmes ayant pris part à la révolte sont moins sévèrement punies que les hommes parce qu’on ne les jugeait pas capables de s’impliquer activement dans les événements, mais aussi parce qu’on les croyait plus manipulables et que la justice espérait ainsi obtenir d’elles des informations en échange de la clémence. Quant à Lumina Sophie, elle fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité, non pas, nous dit l’auteur, en raison de son rôle dans l’insurrection, mais pour avoir refusé de se conformer aux codes moraux en vigueur, à l’image « de douceur, de soumission et de réserve » qui convenait alors aux femmes… Les pages sur ce que Pago nomme « la fracture culturelle » sont également édifiantes. Au cœur des rapports sociaux se situe, en effet, l’usage de la langue créole, méprisée par les classes dominantes, alors que les Noirs sont, eux, le plus souvent et faute d’instruction satisfaisante, incapables de s’exprimer en français. Cette barrière linguistique en révèle d’autres, plus profondément ancrées dans les mentalités, comme cet attachement à la « virginité » que les maîtres se font une fierté de préserver, en ne serrant pas la main des anciens esclaves ou en refusant de trinquer avec eux !
6Le livre se conclut par le sort des condamnés : 8 fusillés et plus de 90 bagnards, dont Auguste Villard qui partit en Nouvelle-Calédonie sur le même bateau que Louise Michel et Henri Rochefort… Mais surtout, il note que les grands gagnants de l’histoire furent les possédants, c’est-à-dire la caste des békés, qui maintinrent intactes les bases de leur prééminence avec leur toute-puissance économique. Les conditions salariales des ouvriers agricoles ne s’améliorèrent pas et la classe moyenne de couleur, bien que mieux représentée politiquement, n’est pas parvenue à capter une part substantielle de la richesse des Blancs. Restés à l’écart du soulèvement, ces petits bourgeois n’avaient de toute façon pas la volonté de remettre en cause la colonisation et le système capitaliste. En définitive, plutôt que de nous ramener à la synchronie des révoltes des années 1870-1871, l’insurrection de Martinique nous interroge sur la pérennité des structures coloniales dans les Antilles françaises, aux sources de l’explosion mémorielle de ces deux dernières décennies, comme des grandes grèves de 2009, en Guadeloupe, contre la « pwofitasyon ». Les révoltés de 1870 souhaitaient en finir avec l’arrogance des Blancs qu’il fallait empêcher « de jouir plus longtemps ». Près d’un siècle et demi plus tard, ce combat continue.