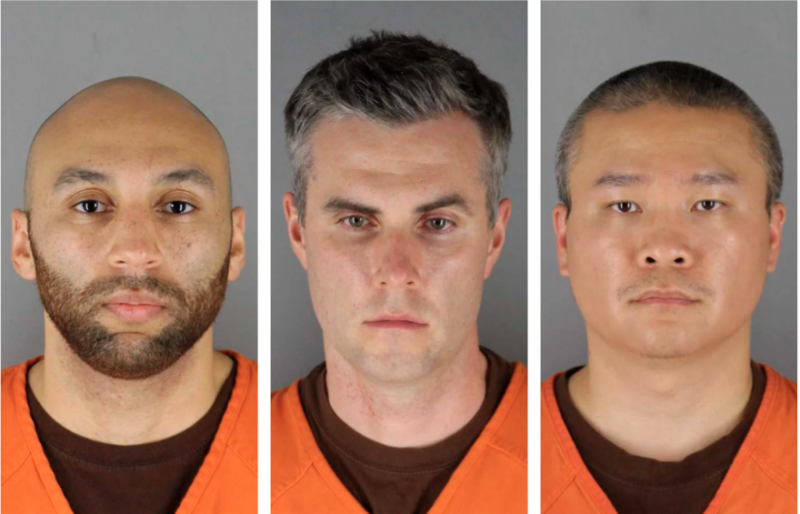Par Xavier Dupré de Boulois, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne
Points clés :
- Si la mise en place d’un nouveau régime d’exception en matière sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a pu être critiquée, il est le meilleur « véhicule juridique » pour fonder et encadrer l’adoption des mesures nécessaires à la lutte contre la pandémie de la covid-19
- Pour autant, ce régime a vocation à faire l’objet d’une « co-construction » associant les différents acteurs du droit dans un régime démocratique afin en particulier d’établir un équilibre entre les nécessités de l’action publique et la protection des droits
- Sa modification par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 constitue une première étape en ce sens
La mise en place par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’un nouveau régime d’exception afin de lutter contre la pandémie de la covid-19, – l’état d’urgence sanitaire -, n’a pas suscité l’enthousiasme des commentateurs. Il a été évoqué son inutilité puisque le droit français serait déjà doté de dispositifs permettant aux autorités publiques de faire face à la crise ; elle présenterait aussi de graves dangers pour l’exercice des droits et libertés fondamentaux au regard des pouvoirs conférés au premier ministre en particulier (P. Cassia, L’état d’urgence sanitaire: remède, placebo ou venin juridique ? : Blog Médiapart, 24 mars 2020). À l’occasion de la première révision de ce régime par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, à peine un mois et demi après sa création, nous souhaiterions faire entendre une expression dissonante à travers l’éloge de ce nouveau dispositif codifié aux articles L. 3131-12 et s. du Code de la santé publique.
Une création opportune
Le débat autour du régime de l’état d’urgence sanitaire (EUS) s’est d’abord cristallisé sur l’opportunité de mettre en place un nouveau régime d’exception alors que le droit français est déjà fort bien pourvu en la matière. Il nous semble pourtant que la solution retenue par le Gouvernement était la meilleure ou pour être plus juste, la moins mauvaise d’entre elles. Partant du constat que cette crise inédite appelait l’édiction de mesures exorbitantes et particulièrement attentatoire aux libertés les plus essentielles, la question a été de déterminer le « véhicule juridique » le plus adapté pour fonder juridiquement leur adoption. L’étude d’impact de la loi du 23 mars 2020 a recensé trois supports normatifs susceptibles de jouer ce rôle. Aucun n’était satisfaisant non seulement pour fonder les mesures prises par le Gouvernement mais aussi pour assurer l’encadrement nécessaire de l’action des pouvoirs publics.
La police spéciale sanitaire
Le premier est le régime de police spéciale sanitaire mis en place par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, remanié par la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 et codifié aux articles L. 3131-1 et suivants du Code de la santé publique. Ces dispositions donnent compétence au ministre de la Santé « pour prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie ». Elles dotent donc le ministre concerné de pouvoirs d’autant plus exorbitants qu’elles ne comportent pas de précisions sur les mesures susceptibles d’être prises sur son fondement et guère plus de garanties pour les personnes concernées.
Mobilisé avec parcimonie lors de l’épisode de la grippe A (H1N1) en 2009, ce régime a servi de base juridique pour l’édiction des premières mesures de contraintes intervenues lors de la présente pandémie : mise en quarantaine des personnes ayant résidé à Wuhan et interdiction des rassemblements et des réunions rassemblant un nombre défini de personnes, fermeture d’établissements recevant du public ou encore suspension de l’activité des établissements d’enseignement. Ce « véhicule juridique » s’est toutefois révélé peu adapté au regard en particulier de l’autorité de police en cause. Comme l’a relevé Didier Truchet, les mesures en question, de par leur nature et leur portée, dépassent manifestement le champ des compétences et des capacités opérationnelles d’un tel ministre (D. Truchet, Covid 19 : point de vue d’un administrativiste sanitaire : Blog Juspoliticum, 27 mars 2020). À tout le moins se serait posé rapidement le problème de la légitimité du ministre de la Santé pour imposer de telles restrictions à l’ensemble de la population. Par ailleurs, comme il a déjà été signalé, le régime juridique de cette police spéciale est défini de manière très sommaire par le Code de la santé publique de telle sorte qu’il existe un doute sérieux sur sa constitutionnalité.
La théorie des circonstances exceptionnelles
Le second support repose sur la combinaison de constructions jurisprudentielles centenaires. Il s’agit d’abord du pouvoir de police générale reconnu au premier ministre (initialement au chef de l’État) à partir de l’arrêt Labonne(CE, 8 août 1919) « en dehors de toute délégation législative ». Il en résulte qu’il lui appartient d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire (ex. : CE, 5 juill. 2013, n° 361441 : JurisData n° 2013-013835). Toute- fois, compte tenu de l’exorbitance des mesures devant être prises pour lutter contre la pandémie, sa mise en œuvre devait être combinée avec la théorie des circonstances exceptionnelles. Cette construction issue de deux arrêts du Conseil d’État intervenus à l’occasion de la première guerre mondiale (CE, 28 juin 1918, Heyriès : Rec. CE 1918, p. 651. – CE, 28 févr. 1919, Dol et Laurent : Rec. CE 1919, p. 208) conduit le juge administratif à libérer l’administration du strict respect des règles qui s’imposent à elle au regard des circonstances de temps et de lieu, qu’il s’agisse d’une guerre, d’une insurrection ou autre catastrophe naturelle. Ce « véhicule » n’était pas plus satisfaisant que le premier.
Il peut d’abord être relevé que le pouvoir de police générale du premier ministre ne connait pas d’autre encadrement que celui qui résulte de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la police administrative : les motifs des mesures de police sont définis par référence aux composantes habituelles de l’ordre public ; elles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Surtout, cette démarche aurait conduit à une dénaturation de la théorie des circonstances exceptionnelles. D’une simple « soupape » mobilisée au cas par cas et a posteriori par le juge administratif pour écarter le recours contre une décision administrative, elle serait devenue un régime d’exception à part entière de nature à fonder a priori l’adoption de mesures réglementant l’exercice des libertés. Un régime au demeurant bien sommaire, puisqu’il se résumerait à une sorte de maxime : « le gouvernement est libéré du respect de la loi lorsque des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu le justifient ». Au total, se reposer sur cette combinaison de jurisprudences centenaires aurait constitué une régression importante de la garantie des droits et libertés.
La loi du 3 avril 1955
Le troisième « véhicule juridique » envisagé par l’étude d’impact de la loi du 23 mars 2020 était le recours au régime de l’état d’urgence issu de la loi du 3 avril 1955. Il est vrai que prima facie, l’application du régime établi par la loi de 1955 pouvait s’envisager dès lors que son article 1er autorise son déclenchement « en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ». Il n’y aurait guère eu d’effort à faire pour qualifier la pandémie de la covid-19 de calamité publique au sens de cette disposition. Le problème est que le régime d’état d’urgence de la loi de 1955 a une forte coloration sécuritaire de telle sorte qu’il n’aurait guère pu être applicable tel quel à une crise sanitaire. Cette coloration sécuritaire est très nette lorsque l’on se réfère aux différentes mesures susceptibles d’être édictées en application de ce régime. L’article 5 de la loi de 1955 précise ainsi que les mesures d’interdiction de circulation de personnes et des véhicules et les mesures d’interdiction de séjour des personnes ne peuvent être justifiées que par un « but de prévention des troubles à la sécurité et à l’ordre public ». De même, son article 6 précise qu’une mesure d’assignation à résidence ne peut viser que les personnes « à l’égard [desquelles] il existe des raisons sérieuses de penser que [leur] comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». D’autres mesures prévues par la loi de 1955 sont, quant à elles, inadaptées dans le contexte de la lutte contre une crise sanitaire. On pense par exemple à la dissolution de groupements ou d’association (art. 6-1) et aux perquisitions administratives (art. 11). Il en résulte que la mise en œuvre de l’état d’urgence pour lutter contre la pandémie aurait supposer une révision importante de la loi de 1955 pour l’adapter aux nécessités liées à une crise sanitaire. Si ses dispositions relatives au déclenchement et à la fin de l’état d’urgence auraient pu pour l’essentiel être applicables aux différentes situations de crise, la loi de 1955 aurait dû définir deux catégories de mesures adaptées respectivement à l’état d’urgence sécuritaire et à l’état d’urgence sanitaire. Autrement dit, le recours au régime de la loi de 1955 n’aurait pas permis de faire l’économie de l’introduction massive de dispositions spécifiquement consacrées aux crises sanitaires.
Au regard de ces différents éléments, le choix d’élaborer un nouveau « véhicule juridique » pour lutter contre la pandémie a été opportun. Lui seul permettait de pourvoir aux nécessités de la lutte contre une telle pandémie ; surtout lui seul était susceptible de permettre la mise en place d’un cadre juridique de nature à assurer la prise en compte des droits et libertés des personnes. De manière générale, cette garantie a beaucoup à gagner d’une définition précise et serrée des prérogatives que les autorités publiques peuvent mettre en œuvre en cas de crise grave. Une telle considération justifierait au demeurant de remettre à l’ordre du jour la question de l’abrogation de l’article 16 de la Constitution qui n’en finit pas d’être désuet et dangereux au regard de l’évolution du droit français de l’exception.